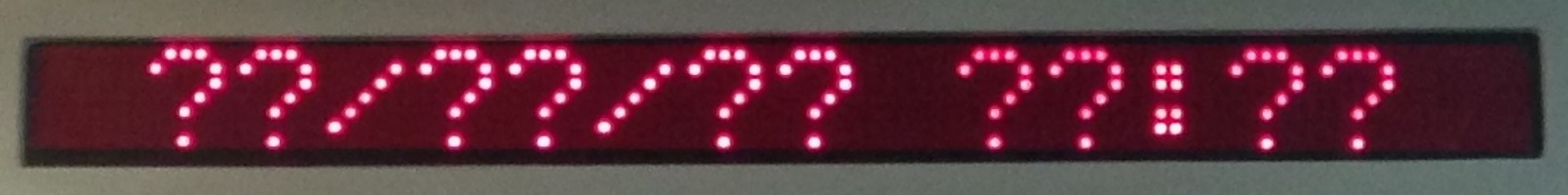L’artiste portugais Pedro Cabrita Reis (qui a eu quelques expositions en France : Toulon, Marseille, les Tuileries) est un personnage, comme on dit (même les non-lusophones le percevront dans cette interview). Il vient d’organiser dans un bâtiment désaffecté (un ancien asile, qu’on pourrait presque appeler aussi « folie ») une rétrospective – avalanche de son oeuvre sur 3000 mètres carrés avec 1500 oeuvres (jusqu’au 28 juillet). Aucune chronologie, aucune thématique, aucune légende (donc pas de légendes sous mes photos), on erre le nez en l’air dans huit pavillons où cohabitent sculptures, installations, toiles, dessins, aquarelles, quelques photographies ; des oeuvres de son adolescence, et d’autres réalisées la semaine dernière, côte à côte. Plutôt qu’un Atelier (titre donné à l’exposition), on pense à une réserve particulièrement désorganisée.

Il ne faut pas tenter d’en faire une lecture esthétique, et encore moins historienne, il faut se laisser prendre par la folie désordonnée du lieu, se laisser bercer au gré des salles par la magie des rapprochements. C’est un gigantesque montage, une composition effrénée de bariolages et de bricolages. On y trouve, dans une liste folle, un barrage à repeindre, une table aux pieds coulés dans le béton (suis-je le seul à penser à la lupara bianca ?), un niveau à bulle évidemment brisé, des peintures kitsch à demi occultées par de la peinture industrielle. Cabrita, homme d’énergie et de passion, est obsédé par son autoportrait en peinture, des dizaines ici, d’ailleurs plus intéressants que ses « paysages » colorés.

Le plus étonnant sont ses grandes sculptures faites de bois, de verre, de néons, de métal, matériaux de récupération assemblés avec art et construisant des géométries rigoureuses et poétiques. Mais quand on a vu (comme à Toulon) la manière dont l’artiste sait occuper un espace, s’y adapter, s’y insinuer, le dynamiter de l’intérieur en quelque sorte, on ressent comme un manque ici, une décontextualisation, devant ces oeuvres déracinées, montrées ici, non comme des parties d’un tout construit, pensé et complexe, mais simplement comme des « oeuvres d’art » exposées.

Sa maquette des Trois Grâces des Tuileries comme sa forêt de tiges de plâtre ou sa partition murale de pneus semblent témoigner d’une recherche constante d’un déséquilibre des formes, d’une destruction de l’harmonie, et c’est le plus réussi dans cet ensemble disparate et prolifique. On en sort sonné, admiratif devant cette énergie, et ne sachant plus trop que penser. Nul doute que ce soit d’ailleurs l’objectif de l’artiste … Dans le catalogue, au milieu de textes plus (trop ?) personnels, j’ai apprécié le regard de Penelope Curtis sur cet « Atelier ».