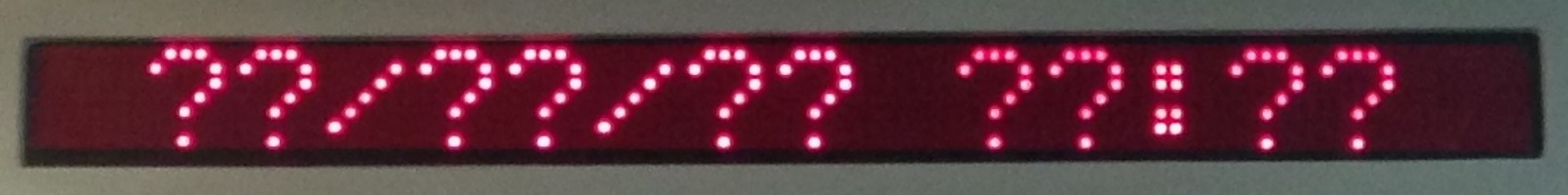En espagnol.
Il me reste, en fait, à écrire un billet assez complet sur l’exposition Photo Brut; mais, comme le livre fait 320 pages, il me faut encore quelques jours. Alors, en attendant, un billet sur les autres expositions des Rencontres d’Arles dont j’ai envie de parler. Tout d’abord, les deux autres lauréats du Prix Découverte (avec Laure Tiberghien) se trouvent être aussi ceux que j’avais le plus remarqués, au milieu de contributions de qualité assez moyenne par ailleurs (excepté Hanako Murakami, aussi mentionnée précédemment). Qui pourrait penser qu’on s’intéresserait à un camp paramilitaire pour adolescents hongrois ? Dès qu’on prononce ces mots, remontent en surface pas mal de préjugés et éventuellement quelques souvenirs pas tous agréables. Et c’est pourtant une excellente exposition que celle de Maté Bartha, jeune artiste hongrois présenté par la galerie Tobe. (et donc co-lauréat du Prix du jury). Lui-même dit avoir d’abord été effrayé par son sujet, par la crainte du militarisme, de la violence. Et puis, passant un an et demi avec ces ados souvent un peu paumés, il a compris comment, grâce à ces contraintes et à cette discipline, ils réussissaient à forger leur personalité, à affiner leurs émotions, comme, dit-il « une expérience libératrice inattendue ». C’est la qualité unique de cette exposition : elle nous fait réfléchir, elle remet en question nos idées toutes faites, elle nous installe dans l’intranquillité, dans l’ambiguïté. C’est rare. Merci à Maté Bartha, dans ce contexte difficile qu’on ne peut oublier.
L’autre exposition du Prix Découverte qui nous remet en question a obtenu le prix du public (les votes des professionnels la première semaine). Aussi improbable qu’un camp paramilitaire hongrois, une nonne orthodoxe biélorusse. Alys Tomlinson, présentée par la galerie Hackelbury (dont je connaissais plutôt le côté photographie expérimentale), a en effet suivi pendant des semaines Soeur Véra, une jeune femme qui a trouvé sa vocation, vit dans un monastère reculé où elle s’occupe des chevaux et travaille avec des hommes dans un programme de réinsertion. La pureté des images, photographies et film en noir et blanc, induit chez le spectateur, athée ou pas, une émotion, un respect qu’on ressent rarement. Là aussi, on en sort troublé, questionné, un peu inquiet.
Sans transition, comme on dit, Krystyna Dul raconte avoir découvert, dans une maison abandonnée, le trésor photographique d’un homme dont elle dit ne rien savoir. Certaines (sacrilège !) sont montrées sur l’autel latéral de la chapelle baroque de la Charité, les autres sont dans une petite tourette qui reprend la cage d’escalier de la maison abandonnée. Et elles tracent en creux le portrait de son « invention », un homme sans doute âgé, qui, désormais trop vieux pour rêver et pour faire rêver, réinvente la mémoire de sa vie amoureuse et sexuelle. Ses fantasmes voyeuristes se traduisent en images érotiques somme toute assez soft, découpes de magazines dits « de charme », petites statuettes, trois Grâces ou Vierge Marie, et clichés plus personnels, souvenirs lointains de maîtresses passées : un érotisme galant d’un autre temps, aux antipodes de la pornographie internet. Krystyna Dul construit ainsi, physiquement et métaphoriquement, un « blason », elle donne à voir sans trop montrer, elle donne à rêver sans trop révéler. Sommes-nous complices de cette intrusion de l’artiste dans une intimité ? En sommes-nous dupes ? C’est aussi, de sa part, une narration fantasmée, elle aussi, où le corps féminin est à la fois glorifié et objectivé, et où le désir masculin ne peut être que convoitise éhontée. Catalogue élégant, avec un beau texte de Christian Gattinoni.
Sans transition encore, la réflexion sur l’impossibilité de montrer d’Emeric Lhuisset. Ce dernier n’est pas qu’un photographe baroudeur au Moyen-Orient ayant démontré sa capacité à sortir des clichés et de l’immédiateté du photojournalisme, il sait montrer aussi la complexité des enjeux de la région, comme il le fit sur l’eau il y a trois ans, mais ici il va, me semble-t-il, plus loin dans sa réflexion sur la photographie et son rapport au monde, peut-être grâce au stimulus du Prix BMW (dont on ne dira jamais assez à quel point il s’est amélioré depuis 2017 et Dune Varela). Au premier niveau, cette exposition parle des Kurdes et de l’oppression dont ils souffrent; on peut avoir une opinion moins tranchée que lui, évoquer le génocide arménien ou les manipulations israéliennes, mais le vrai sujet n’est pas là. C’est plutôt le fait de ne pas savoir voir, de ne pas vouloir voir, de lutter contre l’évidence, qui est central ici. On ne peut documenter une disparition (ni un génocide ou une épuration ethnique) que par des traces, des caches, des absences, des empreintes. L’image ci-dessus est une photo aérienne d’une ville de l’Est de la Turquie, où les quartiers kurdes, bombardés, ont été découpés dans l’image même : un double index photographique en quelque sorte, visuel et matériel. Quand on est empêché de viser le réel, on en est réduit à photographier le ciel et les nuages, à filmer l’approche, faute de pouvoir montrer son sujet véritable. Emeric Lhuisset fait ici quelques pas vers une démarche plus conceptuelle, plus détachée du réel (qu’il ne pourra peut-être accomplir pleinement que sur un sujet le touchant moins personnellement); sur ce chemin, il rencontrera peut-être Walid Raad ou W.G. Sebald. Le catalogue est un beau livre d’artiste avec un encart titré Bulutlar (nuage).
Et enfin, un paragraphe rapide pour finir avec quelques expositions sur lesquelles j’ai peu à dire. Bien aimé la Zone, très bien documentée. Bien ri aux images burlesques du CNRS. Séduit par la mise en scène de l’exposition-jardin, moins par les images très classiques de Mario del Curto. Pas vraiment convaincu par les expositions « écolos », bien trop convenues et sans surprise (Sur terre, le commerce équitable, …), ni par celles sur la maison ( ni celle-ci, ni encore moins la mise en scène domestique de celle-là ). Déploré la commercialisation à marches forcées de Mohamed Bourouissa : content de revoir ses travaux anciens, et déçu de voir ce qu’il est devenu, sans doute trop influencé par son galeriste. Regretté de n’avoir pu voir Pouillon (ayant vécu un an dans un de ses complexes en Algérie, je suis un grand fan de l’architecture de Fernand Pouillon). Et beaucoup regretté d’avoir manqué la présentation à Voies Off de Shelbie Dimond, fille de témoins de Jehovah qui s’est enfuie, et explore le corps un peu dans la lignée de Francesca Woodman, « quelque part entre psychose et neurose« . Et voilà (en attendant Photo Brut).