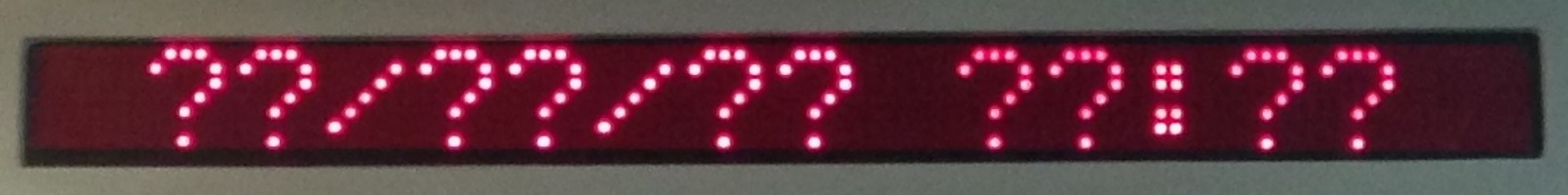English translation
Les critiques sur l’exposition Guy Debord à la Bibliothèque Nationale (jusqu’au 13 juillet) portent la plupart du temps sur l’incompatibilité présumée entre la pensée, la morale de Debord et le fait d’être exposé dans une grande institution de l’état, d’être désormais récupéré par le spectacle, reconnu comme une icône nationale, un trésor national, ou, accessoirement, sur le pactole que sa veuve a reçu pour ces archives et sur les riches donateurs qui ont contribué à leur acquisition (dans une lettre du 25 juin 1968 à Michèle Bernstein, Debord n’écrivait-il pas : «il faut se méfier des gens de l’ex CMDO [le comité de Mai 68 regroupant situationnistes et enragés] ; il y en a peut-être même qui quémandent de l’argent dans l’intelligentsia en parlant plus ou moins vaguement de l’I.S. Il ne faut absolument pas être mélangé à ces fantaisistes. »). Les critiques portent sur la spectacularisation de Debord, parfois aussi sur le fait que les autres situationnistes n’apparaissent dans cette exposition que sous l’angle de Debord, réel ou présumé, et qu’il y a là une certaine forme de trahison, d’appropriation ; sans compter ceux qui en profitent pour régler leurs comptes avec la BnF pour des histoires de copyright ou à cause de la procédure de mise à disposition du public de textes inaccessibles (qui soulève un tollé élitiste que je comprends mal, mais ce n’est pas le sujet), pratiques qui devraient interdire à la BnF d’exposer Debord, si on les en croit…

Détail d’une photo publiée dans l’I.S. n°5, décembre 1960, p.21. Conférence de Londres de l’I.S.
Avec tous ces a priori, rares sont les critiques qui parlent vraiment de l’exposition même et du Debord qu’elle laisse entrevoir, trop dérangeant pour certains peut-être. N’appartenant à aucune des chapelles, ayant été, comme tout un chacun, émerveillé à vingt ans par la Société du Spectacle (et aussi par le Traité de savoir-vivre de Vaneigem, et le décapant De la Misère en milieu étudiant : l’étudiant en faux rebelle mais vrai conservateur; tous livres que, comme Sollers, je lisais aussitôt, dans la rue entre la librairie où je les avais achetés et mon domicile), ayant trouvé dans cette pensée sur le fil du couteau une antidote vivifiante à la ‘bouillie académico-gauchiste’, comme dit Assayas, ayant, depuis, un peu lu, j’ai, pour ma part, apprécié cette exposition (peut-être aussi parce que j’eus le privilège de la visiter une seconde fois en compagnie de la seule survivante de la photo de groupe qui fait affiche, Jacqueline de Jong, exclue en 1962).

Inscription de Guy Debord sur le mur de l’Institut, Paris 1953
Je l’ai appréciée d’abord parce que, au-delà de la richesse des documents présentés (on peut seulement regretter que, dans les 6h45 de films présentés à côté de l’exposition, manque le très ‘discrépant’ Hurlements), elle s’attache à montrer, à partir des archives, le mode de pensée et de travail de Debord. La salle ovoïde où sont présentées ses fiches de  lecture, les citations qu’il recopie et qu’il classe, bristols désormais tous estampillés en écho de l’ovale rouge BnF comme une Légion d’Honneur, ne m’a semblé ni une récupération, ni une spectacularisation : le but n’est pas de lire chacune de ces fiches, mais de montrer visuellement comment la pensée de Debord s’ancrait dans une impressionnante érudition littéraire, ce qui est plus aisé dans une thèse que dans une exposition. On y relève parfois l’annotation ‘det.’ pour détournable… Le détournement est au centre même de la démarche de Debord, adepte de la citation, du collage, du montage incongru (pas si loin d’ailleurs des surréalistes honnis, même si sa pratique en la matière est plus intellectuelle qu’onirique). Il faut d’ailleurs lire le volume paru chez Actes Sud, ‘La Fabrique du Cinéma de Guy Debord‘ qui montre éloquemment comment il reprend et détourne des images de toutes origines pour les intégrer à ses films.
lecture, les citations qu’il recopie et qu’il classe, bristols désormais tous estampillés en écho de l’ovale rouge BnF comme une Légion d’Honneur, ne m’a semblé ni une récupération, ni une spectacularisation : le but n’est pas de lire chacune de ces fiches, mais de montrer visuellement comment la pensée de Debord s’ancrait dans une impressionnante érudition littéraire, ce qui est plus aisé dans une thèse que dans une exposition. On y relève parfois l’annotation ‘det.’ pour détournable… Le détournement est au centre même de la démarche de Debord, adepte de la citation, du collage, du montage incongru (pas si loin d’ailleurs des surréalistes honnis, même si sa pratique en la matière est plus intellectuelle qu’onirique). Il faut d’ailleurs lire le volume paru chez Actes Sud, ‘La Fabrique du Cinéma de Guy Debord‘ qui montre éloquemment comment il reprend et détourne des images de toutes origines pour les intégrer à ses films.

Guy Debord, sans titre, entre 1957 et 1962, collage et peinture selon le principe des métagraphies lettristes, 53.5x71cm, coll. Michèle Bernstein
L’intéressant est bien sûr la richesse des documents inédits, les pistes qu’ils ouvriront pour des chercheurs, l’importance des témoignages (il faut absolument voir les interviews faites par Olivier Assayas, inédites et dont la diffusion hors exposition n’est pas programmée). La période formative, les premières années lettristes (une découverte étonnante au gré des pages : le n°1 du Front de la Jeunesse, revue lettriste de 1950, appelle à la libération des miliciens emprisonnés à la Libération), l’Internationale Lettriste (pourquoi l’appeler lettriste, demande-t-on à Debord puisqu’elle est dirigée contre le lettrisme ? parce que c’est un mot déjà connu, et que ça sonne bien, répond-il, déjà adepte du spectacle) sont particulièrement éclairantes. L’attention donnée à la forme est aussi un fil conducteur à suivre ici, du nuancier de la couverture métallisée de la revue au soin extrême avec lequel les tracts sont composés ; il écrit aussi à Jorn en 1957 ces propos révélateurs : « Il nous faut créer tout de suite une nouvelle légende à notre propos ».

Exemple de détournement de comics
On peut se perdre dans la richesse des documents, s’éterniser dans les salles si l’on veut tout lire, passer des heures dans le remarquable catalogue, découvrir tous les tracts, toutes les proclamations. Mais on peut aussi se concentrer sur les moments les plus critiques, sur la rupture à la perpendiculaire de 1961/62 par exemple, quand l’Internationale Situationniste se transforme d’un mouvement principalement artistique et poétique en un mouvement principalement politique : au lieu d’élaborer le spectacle du refus, dit-il alors, il faut refuser le spectacle, ne pas l’enrichir, mais le réduire. C’est à ce moment que les artistes, en particulier le groupe Spur, Asger Jorn et Jacqueline de Jong, sont exclus ; on découvre à quel point la diatribe et l’exclusion sont essentielles dans le développement de l’IS (pratiques qui rappellent quelque peu Breton, qui, lui, fit le choix inverse, s’éloigner du politique). Un des bijoux de l’exposition, fort révélateur, est la première version de Mémoires, reliée en papier de verre pour détruire les livres qu’on oserait éventuellement leur juxtaposer.

Jacqueline de Jong, Linogravures, Mai 68
Chacun s’attachera ici aux sujets qui lui sont chers, Mai 68, la stratégie ou la cartographie, par exemple, ou bien les détournements. Sur Mai 68 il est fascinant de voir que les situationnistes (avec les enragés), chassés le 17 mai de la Sorbonne par les leaders étudiants, ont quasiment disparu de l’histoire du mouvement, car elle fut écrite essentiellement par des trotskystes et des maoïstes (et Debord reste aujourd’hui un des meilleurs outils critiques de la bonne conscience de gauche, quelque peu sous-utilisé, mais si pertinent). La stratégie est le schéma directeur de l’exposition, aux titres de section guerriers (Mai 68 : la charge de la Brigade Légère) et qui se termine avec le Jeu de la Guerre : c’est un choix intéressant, éclairant, mais qui ne saurait rendre compte de l’ensemble du travail de Debord et qu’il faut prendre avec un peu de recul.

Guy Debord, Le jeu de la guerre, 1978, cuivre argenté, 34 pièces, 38.5×46.5cm, BnF
La cartographie, les dérives, la psycho-géographie, auraient à mon sens mérité un peu plus de place tant elles me semblent être un des principaux ancrages de Debord dans une histoire du flâneur qui va de Baudelaire à Tichý, mais c’est là une de mes obsessions (Tichý post-situationniste ? Sanguinetti l’a bien connu, a écrit un texte remarquable sur lui et l’a exposé à Prague, et mon récent texte sur sa réception critique a été publié sur le site de dévotion situationniste américain Not Bored!). La psycho-géographie poétique mène à l’urbanisme, dont la seule trace ici (mais, rappelons-le c’est une exposition sur Debord, pas sur tout le mouvement, contrairement à celle d’Utrecht) est une maquette utopique de Constant, New Babylon, en rapport avec le camp de gitans hébergé dans sa propriété par le merveilleux Pinot-Gallizio.

Guy Debord, The Naked City, « illustration de l’hypothèse des plaques tournantes en psychogéographique », imprimé à Copenhague, mai 1957; plan 33x48cm, BnF
Debord aurait-il accepté cette exposition ? C’est une question vaine et sans réponse ; ses veuves, Michèle Bernstein comme Alice Ho l’ont soutenue. Mais lui ? Lui qui n’aimait rien tant que les losers magnifiques, Don Quichotte, le consul Geoffrey Firmin, ou Uncle Toby de Tristram Shandy (et aussi le cardinal de Retz, rebelle à sa classe) ? Lui qui était si soucieux d’archives et de droit d’auteur, lui qui se préoccupa de la transmission de ses écrits et les confia à Buchet-Chastel puis à Gallimard, entreprise culturelle établie par excellence, se serait-il senti trahi par le travail éclairé, humble et sensible des deux commissaires ? Trop nombreux sont ceux qui s’arrogent le droit de parler en son nom, me semblent-il [et on en voit, bien sûr, bien des exemples dans les commentaires, ici et ailleurs].
On en sort la tête pleine et dans les nuages, subjugué par la dimension à la fois intellectuelle, politique et artistique de Guy Debord (et de ses compagnons) en se demandant qui aujourd’hui parvient à combiner cette position politique et cette force artistique (dans la forme et le style autant sinon plus que dans le fond) : sûrement pas les ‘pro-situs‘ contemporains, idolâtres dogmatiques et vieillots (comme le site américain intervenant ci-dessous), ni les artistes qui prétendent parler de politique en récupérant des slogans, comme Claire Fontaine, ou en se marketant en contradiction totale avec leur propos (comme Société Réaliste). Non, personne, en tout cas en Occident, et c’est sans doute la preuve ultime que Debord avait raison, que la société du spectacle a gagné, et que cette exposition se justifie parfaitement.
Photos 3, 4, 6 & 7 de l’auteur; photos 1 & 8 courtoisie de la BnF.