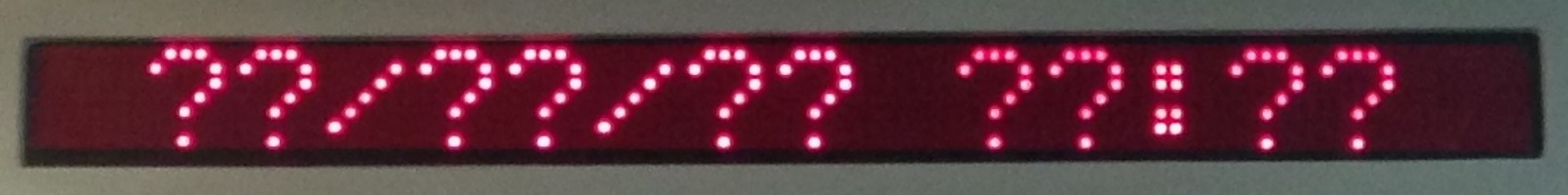De retour à la Biennale de Lyon* (qui dure jusqu’au 6 janvier), j’ai pu revoir plus longuement certaines vidéos et certains spectacles, errer plus longuement dans les salles. Errer, justement. Dans la majorité des cas, ici comme ailleurs, mon corps, le corps du visiteur, est passif : il passe devant les cimaises, fait le tour des sculptures, s’asseoit sur un banc ou s’appuie contre un mur (voire se couche sur un coussin pour les 180 minutes du film de Chris Marker au MAC), il se met là où on lui enjoint de se mettre, ne franchit pas les petites barrières, ne touche pas aux oeuvres.
Et puis, il y a quelques rares oeuvres où mon corps se retrouve en jeu, où, de simple visiteur, je deviens plus que spectateur, participant, sinon acteur. Ce fut l’invention du happening il y a 50 ans, par exemple. Alors, cette revisite de la Biennale, je me suis dit que j’allais la faire sous cet angle-ci, à propos de quatre oeuvres, toutes temporaires, transitoires.
La première, on ne sait si c’est de l’art « plastique » ou du spectacle. Pierre Bal-Blanc, du Centre de Brétigny a invité les deux chorégraphes Annie Vigier et Franck Apertet avec leur spectacle X-event. La scène est une salle carrée dont chaque mur est percé d’une large ouverture.  Les cinq danseurs évoluent au centre de la salle, on peut les voir de loin, comme en passant, on peut aussi se presser à chaque ouverture, parfois dans la foule, hausser la tête, regarder à demi-distance, sans trop s’engager, en se réservant la possibilité de partir sans trop déranger au bout de quelques minutes. Mais on peut aussi entrer dans la salle, se coller le long du mur, comme plaqué contre la paroi par le souffle des danseurs; restant d’abord debout, on se laisse peu à peu glisser au sol, assis, à demi vautré. Rares sont les audacieux qui vont déambuler dans l’espace, passer entre les danseurs, les contourner. C’est que leurs danses vous tiennent à distance.
Les cinq danseurs évoluent au centre de la salle, on peut les voir de loin, comme en passant, on peut aussi se presser à chaque ouverture, parfois dans la foule, hausser la tête, regarder à demi-distance, sans trop s’engager, en se réservant la possibilité de partir sans trop déranger au bout de quelques minutes. Mais on peut aussi entrer dans la salle, se coller le long du mur, comme plaqué contre la paroi par le souffle des danseurs; restant d’abord debout, on se laisse peu à peu glisser au sol, assis, à demi vautré. Rares sont les audacieux qui vont déambuler dans l’espace, passer entre les danseurs, les contourner. C’est que leurs danses vous tiennent à distance.  Deux des six étaient présentées ce jour là, Chutes, où le groupe passe d’une atonie horizontale à des soubresauts violents où ils se jettent au sol en ahanant (ci-dessus photo, mais en un autre lieu), et Salives, où presque nus, les danseurs en groupe compact évoluent lentement au sol à travers la pièce, certains couchés, d’autres debout laissant couler leur salive sur leurs partenaires (ci-contre). Spectateur toléré dans l’espace chorégraphique, n’osant trop m’approcher, ni trop bouger, mon corps dans son rapport au leur, et partant au spectacle, reste timide, figé, consommateur.
Deux des six étaient présentées ce jour là, Chutes, où le groupe passe d’une atonie horizontale à des soubresauts violents où ils se jettent au sol en ahanant (ci-dessus photo, mais en un autre lieu), et Salives, où presque nus, les danseurs en groupe compact évoluent lentement au sol à travers la pièce, certains couchés, d’autres debout laissant couler leur salive sur leurs partenaires (ci-contre). Spectateur toléré dans l’espace chorégraphique, n’osant trop m’approcher, ni trop bouger, mon corps dans son rapport au leur, et partant au spectacle, reste timide, figé, consommateur.
 La seconde est interactive, ludique, trop aux yeux de certains, j’en ai déjà parlé ici (et là aussi). C’est l’installation de Shilpa Gupta (Untitled) où mon corps devient visible, mon ombre est projetée sur l’écran, devient un élément du spectacle. De plus, je ne peux rester immobile, passif, je dois participer, bouger, entrer dans le jeu, éviter les projectiles. L’artiste me prend à partie, me somme de réagir, d’abolir la distance entre spectateur et oeuvre. On peut voir ça comme un exercice futile, trop évident, trop distrayant, et certains ayatollahs de l’art contemporain pur et dur le clament haut et fort; on peut aussi y voir, comme moi, un des avatars du happening, dérangeant, « borderline », aux promesses encore indécises.
La seconde est interactive, ludique, trop aux yeux de certains, j’en ai déjà parlé ici (et là aussi). C’est l’installation de Shilpa Gupta (Untitled) où mon corps devient visible, mon ombre est projetée sur l’écran, devient un élément du spectacle. De plus, je ne peux rester immobile, passif, je dois participer, bouger, entrer dans le jeu, éviter les projectiles. L’artiste me prend à partie, me somme de réagir, d’abolir la distance entre spectateur et oeuvre. On peut voir ça comme un exercice futile, trop évident, trop distrayant, et certains ayatollahs de l’art contemporain pur et dur le clament haut et fort; on peut aussi y voir, comme moi, un des avatars du happening, dérangeant, « borderline », aux promesses encore indécises.
 La troisième est plus perverse, non point tant parce qu’elle offre un strip-tease même pas intégral (ce corps-ci en a vu d’autres) mais parce qu’elle vous prend en porte-à-faux. La relégation de ces trois sculptures minimalistes (de Dan Flavin, Dan Graham et Larry Bell) dans un coin de cette immense salle, et leur utilisation, au sens propre, comme accessoires du strip-tease (miroir, porte-manteau, néon) font bien sûr hurler tout amateur d’art qui se respecte. Ou pas ? Dan Graham a, paraît-il, adoré. Après une ou deux performances de Selling Out (2003) de Tino Sehgal, c’est la salle que je regarde plus que le danseur (ou la danseuse) : comment les corps l’occupent, où ils se positionnent. Restent-ils immobiles ou se déplacent-ils ? Pour mieux voir ou pour se mettre hors de portée d’une éventuelle intrusion du strip-teaseur qui, parfois, s’approche lascivement d’une spectatrice désemparée et ne danse plus que pour elle ? Entre deux performances, l’actrice (ou l’acteur), habillée, badgée comme un gardien de musée, se promène dans la salle. Son corps, désexué, est au même plan que le mien, je la croise négligemment, elle me regarde de manière neutre. Mais tous savent que dans un instant, ce rapport ne sera plus le même, ce regard sera autre. Le plus intéressant est l’intervalle, justement, la « production d’art » qui se crée à cet instant, dans cette attente (photos interdites, bien sûr).
La troisième est plus perverse, non point tant parce qu’elle offre un strip-tease même pas intégral (ce corps-ci en a vu d’autres) mais parce qu’elle vous prend en porte-à-faux. La relégation de ces trois sculptures minimalistes (de Dan Flavin, Dan Graham et Larry Bell) dans un coin de cette immense salle, et leur utilisation, au sens propre, comme accessoires du strip-tease (miroir, porte-manteau, néon) font bien sûr hurler tout amateur d’art qui se respecte. Ou pas ? Dan Graham a, paraît-il, adoré. Après une ou deux performances de Selling Out (2003) de Tino Sehgal, c’est la salle que je regarde plus que le danseur (ou la danseuse) : comment les corps l’occupent, où ils se positionnent. Restent-ils immobiles ou se déplacent-ils ? Pour mieux voir ou pour se mettre hors de portée d’une éventuelle intrusion du strip-teaseur qui, parfois, s’approche lascivement d’une spectatrice désemparée et ne danse plus que pour elle ? Entre deux performances, l’actrice (ou l’acteur), habillée, badgée comme un gardien de musée, se promène dans la salle. Son corps, désexué, est au même plan que le mien, je la croise négligemment, elle me regarde de manière neutre. Mais tous savent que dans un instant, ce rapport ne sera plus le même, ce regard sera autre. Le plus intéressant est l’intervalle, justement, la « production d’art » qui se crée à cet instant, dans cette attente (photos interdites, bien sûr).
La dernière pièce est pour moi la plus fascinante. Je n’ai pas vu The show must go on de Jérôme Bel à l’Opéra de Lyon, mais seulement sa transposition adaptée au MAC : on vous remet à l’entrée un écouteur et vous déambulez à travers six salles entièrement vides, l’une toute noire, une autre avec un grand miroir au mur, une troisième avec une vue sur le Parc de la Tête d’Or (ci-dessous), les trois autres aussi neutres que possible. Dans chaque salle,  on entend, dans l’écouteur, une chanson : le principe même de l’audioguide. Il y a trois versions, chanson française, variété internationale, et chanson pour enfant. Tout cela est très entraînant et on se retrouve rapidement en train de battre des pieds, d’esquisser un pas de danse, de laisser le corps s’exprimer. L’écouteur me coupe du monde, je suis seul avec la musique, mon corps est dans une bulle hors temps, hors société. Quand ce plaisir là s’émousse un peu, quand j’ai écouté toutes les chansons des trois versions, un nouveau plaisir naît, celui de regarder les autres, de les voir bouger, les yeux mi-clos, la mine ravie. Quelle chanson écoute cette jeune fille au sac rouge pleine d’allégresse ? et ce monsieur nostalgique, est-ce Piaf ou Sinatra qui l’emporte ? Parfois, on se sourie, on se reconnaît, comme des membres d’une confrérie, on fait semblant un instant de danser ensemble, un lien social se crée furtivement. Mon corps est devenu acteur, représentation, élément d’un tout.
on entend, dans l’écouteur, une chanson : le principe même de l’audioguide. Il y a trois versions, chanson française, variété internationale, et chanson pour enfant. Tout cela est très entraînant et on se retrouve rapidement en train de battre des pieds, d’esquisser un pas de danse, de laisser le corps s’exprimer. L’écouteur me coupe du monde, je suis seul avec la musique, mon corps est dans une bulle hors temps, hors société. Quand ce plaisir là s’émousse un peu, quand j’ai écouté toutes les chansons des trois versions, un nouveau plaisir naît, celui de regarder les autres, de les voir bouger, les yeux mi-clos, la mine ravie. Quelle chanson écoute cette jeune fille au sac rouge pleine d’allégresse ? et ce monsieur nostalgique, est-ce Piaf ou Sinatra qui l’emporte ? Parfois, on se sourie, on se reconnaît, comme des membres d’une confrérie, on fait semblant un instant de danser ensemble, un lien social se crée furtivement. Mon corps est devenu acteur, représentation, élément d’un tout.
Quatre mises en jeu de mon corps, quatre expériences un peu différentes de ce qu’on fait habituellement dans un musée, quatre affirmations de voies nouvelles, peu explorées, dérangeantes peut-être.
* cliquez sur « le projet artistique 2007 », puis sur « Liste des artistes ».
Photo 1 provenant du site des artistes. Photos 2 et 3 provenant du site de la Biennale. Photo 4 de source inconnue. Photo 5 de l’auteur.