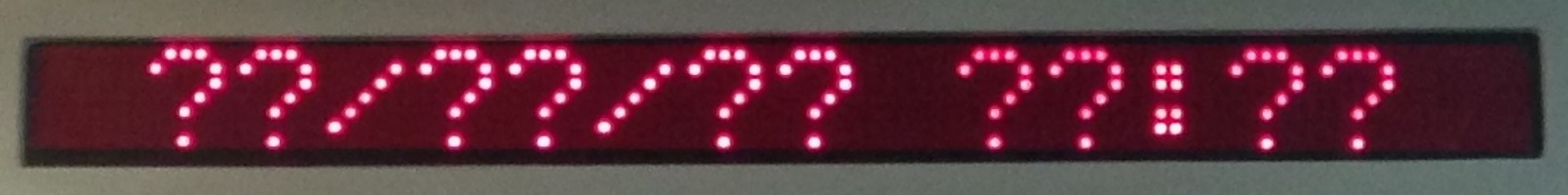C’est au sous-sol du Centre Pompidou (jusqu’au 22 juillet), il n’y a pas de catalogue (on peut acheter ce livre de la Kunsthalle Basel, mais tous ses textes sont là) , mais la seconde partie de l’exposition est telle que, des jours après, vous êtes encore hanté (la première partie, montrant des objets en mouvement, n’est pas à la hauteur de l’expérience qu’on va avoir en avançant). Hannah Villiger, née en 1951, a souffert de tuberculose aiguë à partir de 1980, et est morte en 1997. Elle emmène son appareil polaroïd avec elle dans sa chambre d’hôpital, qu’elle transforme en studio, et photographie son corps, fragment après fragment, sans narcissisme ni pudeur. Parfois, on voit les moindres détails de son corps, ses poils, sa peau laiteuse, ses grains de beauté, ses nombreuses taches de rousseur ; parfois, au contraire, les images sont délibérément floues, comme les seins ci-dessous. C’est déjà là en soi un travail passionnant sur son corps, sa maladie, le regard d’une femme sur son propre corps. Mais ni problématique identitaire, ni revendication féministe contrairement à ses contemporaines Cindy Sherman, Orlan ou VALIE EXPORT (excepté peut-être dans l’oeuvre ouvertement sexuelle Block VI, qui n’est pas dans l’exposition : voir sa description dans la section « Machine Célibataire » dans cet excellent texte). Je l’avais découverte dans cette exposition il y a 15 ans sur les artistes à l’approche de la mort.

On sait qu’à de rares exceptions près (comme Claricia), ce n’est qu’au milieu du XVIe siècle que des femmes eurent l’audace (et la légitimité) de se représenter elles-mêmes (Sofonisbia Anguissola fut peut-être la première alors). Quant à se représenter nues, il fallut attendre le début du XXe siècle avec Paula Modersohn-Becker en peinture, Olga Rozanova en dessin et Anne Brigman en photographie. Mais encore s’agit-il là de corps plutôt beaux, esthétiques, valorisés. Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que des artistes femmes ont montré leur corps vieilli (Anne Noggle) ou obèse (Jenny Saville). Quant au corps malade, Villiger fut-elle la première femme photographe à le montrer ? (et Nebreda le premier homme ?)

Mais Hannah Villiger, d’origine, est sculptrice. Elle ne va pas se contenter de documenter ainsi la matérialité de son corps souffrant, mais elle va, à partir de ces petits polas, bâtir des ensembles bien plus complexes : rephotographiant les photographies polaroïd, les découpant, les agrandissant au centuple (« pour que je puisse entrer en elles »), les assemblant dans des Blocks monumentaux, les agençant dans des ensembles qui s’éloignent de sa physicalité corporelle, laquelle n’est souvent plus reconnaissable. Son corps devient un matériau artistique (de manière esthétiquement différente, mais avec la même logique anti-corporelle que Jorge Molder), ses autoportraits deviennent des pièces d’un puzzle.

Si, dans cette exposition, les images au mur sont, pour la plupart assez figuratives, celles dans les vitrines (difficiles à photographier) montrent au contraire des compositions quasi abstraites de fragments recomposés où on peut, sans trop savoir, tenter d’identifier un sein, un bras ou une cuisse, mais où en fait, on voit avant tout une sculpture-montage couleur chair sur fond noir. Cette fragmentation du corps a une qualité sculpturale qui peut évoquer Rodin. Il n’y a ni haut, ni bas, le spectateur est désorienté et tourne autour de la vitrine pour tenter de définir un point de vue. Et c’est fascinant.
(c) The Estate of Hannah Villiger.