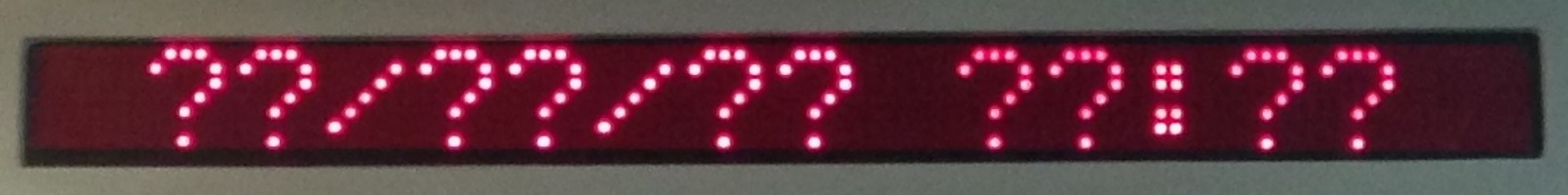Lu Nan, Heilungjian, patients who are seriously ill, are confined to these decaying quarters in the basement of the institution.
Le photographe chinois Lu Nan (qui fait partie de Magnum) a passé 15 ans de sa vie sur trois projets, qui sont présentés au Musée Berardo jusqu’au 14 janvier : les malades psychiatriques, les communautés catholiques, et les Tibétains. Projets de longue haleine, où il a bâti, dans la mesure du possible, des relations de confiance avec ses sujets de manière très empathique. Des centaines de photographies réalistes, en noir et blanc, très bien composées, avec une facture très classique et une grande richesse de nuances (il les tire lui-même), s’alignent au fil des cimaises dans un parcours présenté comme dantesque : enfer, purgatoire et paradis.
Et c’est là que le bât blesse. Non sur la qualité photographique du projet, mais sur ce qui le sous-tend. L’enfer, d’abord : je ne connais pas assez la Chine pour savoir si les hôpitaux montrés ici (7 au total, dont deux, Tianjin -la 4ème ville chinoise- et Heilongjiang, comptent pour l’essentiel des images) sont représentatifs (Lu Nan en a visité 38), mais c’est en effet une vision d’horreur que nous avons là. Du peu que je sais de l’histoire de la psychiatrie en France, il faudrait remonter deux siècles en arrière, ou plus, pour trouver des atrocités similaires : malades enchaînés, laissés nus, dans une saleté immonde, sur des bat-flanc délabrés, dans une promiscuité totale. Les malades sont abattus, oisifs, à peine une ou deux photos les montrent actifs, jouant, riant. On ne voit aucune trace de thérapie, d’interaction avec des soignants. Cela semble bien en effet être l’enfer. Quant aux patients photographiés dans leur famille, ils sont entourés de plus d’affection, mais les conditions ne semblent guère meilleures.

Lu Nan,. Tianjin, Qing Ying, age 12, an extreme case of mental retardation, suffering also from ‘albinism’. She was transferred 2 years previously from an orphanage, everyone in the institution likes her because she is a child….
Une fois exprimée l’émotion ressentie devant ces images, vient l’interrogation : est-ce vraiment ainsi ? Un pays qui, entre confucianisme et communisme, a eu une structure sociale plutôt inclusive, a-t-il toujours laissé ses malades dans cet état ? Ou est-ce un résultat de l’évolution récente du pays vers le capitalisme, laissant de côté les non-productifs ? Lu Nan représente-t-il ce qu’est la norme, ou, au contraire s’est-il intéressé seulement aux cas les plus dramatiques ? Que la psychiatrie ait été utilisée sous le communisme comme un outil de répression, c’est certain; mais ce n’est pas le sujet ici. Qu’il y ait une réticence culturelle à accepter le diagnostic de maladie mentale, c’est probable. Mais ce que je lis, à droite à gauche, (et ceci sur la psychanalyse) ne semble pas peindre un tableau aussi noir. Alors ?

Lu Nan. Shaanxi Province. 1995. Li Hu is 82 years old, he is a faithful believer. He made a coffin for himself 5 years ago, on the coffin is written I BELIEVE IN THE RESURRECTION OF THE BODY…. « I believe in eternal life, this coffin is a hut for my rotten body, but my sould is offered to God » he says.
Le purgatoire ensuite : Lu Nan a photographié des communautés catholiques dans des endroits reculés; on ne voit qu’une seule église en dur, mais surtout des gens priant dans des maisons, ou en plein air. Là encore, face à ces superbes photos, je me sens incompétent : quelle est la liberté d’exercice du culte aujourd’hui ? Non point les luttes politiques au sommet entre Vatican et Pékin, mais la vie quotidienne des fidèles ? Sont-ils persécutés ? Doivent-ils se cacher ? Un site de propagande catholique le proclame sur la base de ces images, mais qu’en est-il vraiment ? Que Lu Nan nous montre-t-il, les « patriotiques » ou les « clandestins » ?
Enfin, le Tibet serait-il le paradis ? Les quatre saisons du travail des champs, la force et la tendresse des relations familiales, la douceur idyllique d’une vie pastorale et agreste sembleraient le montrer. Mais, même pour qui ne connaît pas le Tibet, là encore se pose la question du point de vue du photographe : seules deux images montrent un semblant de religiosité (des paysans remerciant Dieu pour la récolte (quel dieu, d’ailleurs ?), et un homme égrenant son chapelet) : n’y a-t-il donc pas de conflit ethnico-religieux entre Tibétains bouddhistes et Han confuciano-marxistes ? N’y a-t-il pas une forme de colonisation de cette province, économique et culturelle, défaisant peu à peu la société traditionnelle tibétaine ? (Au moins Gao Bo, lui, avait tenté de rajouter un peu de contexte à ses images tibétaines). Cette série rappelle un peu la photographie ethnographique au temps des colonies : montrer les pratiques traditionnelles et les beaux costumes, mais ne rien montrer qui puisse fâcher, remettre en question le système d’exploitation coloniale. Lu Nan semble s’inscrire dans cette lignée. Autant la première partie, même si on pouvait la juger misérabiliste ou voyeuriste, était forte, autant cette section finale semble, au mieux naïve, et au pire manipulatrice.

Lu Nan. Confession, Shaanxi Province (1992). In China, the number of the ordained is far smaller than the Catholic population. Sometimes a Father has to hear nearly a thousand confessions.
On ressort de cette exposition en doutant, non de la sincérité de Lu Nan, homme tout à fait respectable « d’où il parle », mais de la sincérité des images : une approche sentimentale sur commande, empathique, voire voyeuriste et simpliste, rend-elle hommage à la vérité des faits ? On ne peut qu’en douter. Il y a ici beaucoup d’émotion et de talent, mais qui, faute d’une mise en contexte socio-politique, semblent brouiller le tableau plus que l’éclaircir. Mais on sait depuis toujours que la photographie ne dit pas la vérité, mais traduit le point de vue spécifique du photographe. Encore faut-il le reconnaître.
Une anecdote : en préparant cette critique, j’ai découvert que j’avais déjà écrit sur une photographie de Lu Nan (qui n’est pas dans l’exposition), mais je ne l’avais pas crédité, écrivant alors : « voici une œuvre de discorde, car ses auteurs se déchirent sur son copyright : ils furent une demi-douzaine à s’entasser nus au sommet d’une montagne, collaboration spontanée datant de 1995. Cela s’appelle « The anonymous mountain raised by one meter », mais les artistes, eux, ne souhaitent pas rester anonymes et chacun veut s’attribuer la paternité de l’œuvre ; je ne vous en citerai donc aucun. » Lu Nan fut l’un d’eux. Dans un pays qui a surélevé sa montagne culminante pour atteindre 2000m, rappeler cette performance m’a semblé tout à fait approprié.
Photo 5 courtesy Museu Berardo