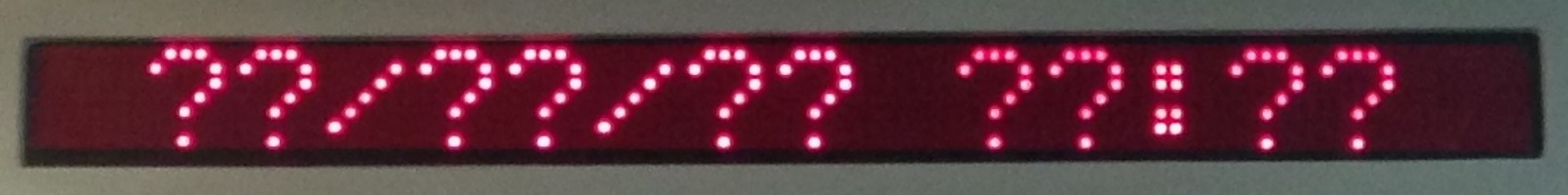[Ma traduction libre d’un extrait du court essai d’Anne McCauley (Professeure d’histoire de la photographie et de l’art moderne à Princeton), « Thoughts on the Triumph of Photography », p.159-162 dans le livre The Meaning of Photography, édité par Robin Kelsey et Blake Stimson, publié par le Sterling and Francine Clark Institute, Williamston, Massachusetts, 2008, 216 pages; actes d’un colloque du 19 novembre 2005, publiés dans la collection « Clark Studies in the Visual Arts ».]

John Hilliard, Camera Recording its Own Condition (7 Apertures, 10 Speeds, 2 Mirrors), 1971, coll. Tate
[…] La vision néo-Kantienne d’Alfred Stieglitz impliquait que la photographie ne pouvait pas être populaire : les regardeurs devaient d’abord comprendre les photographies et voir au-delà de la représentation pour percevoir la beauté et le pouvoir expressif d’une photographie. Mais après 1975 les musées et les écoles d’art, en se multipliant, changèrent de perspective : alors que le travail manuel était délocalisé en Asie et en Amérique Latine, ils attirèrent les étudiants et les chasseurs de coupons publicitaires [« coupon-clippers « , intraduisible : des gens avares et mesquins] qui trouvaient que travailler de leurs mains était quelque chose d’exotique et fascinant. Les musées devinrent de l’infotainment pour des gens qui, quand ils pouvaient s’échapper de leur boulot, préféraient marcher plutôt que d’être assis devant un écran, afin d’avoir une illusion de libre choix en décidant eux-mêmes quoi voir et quand sortir du musée. […]
Mais les gens ont toujours aimé la photographie : voyez le succès de « The Family of Man » et des magazines illustrés des années 20 aux années 50. Ceux qui n’aimaient pas la photographie appartenaient aux élites culturelles ou sociales, comme Edward Robinson du Metropolitan Museum of Art ou Clement Greenberg qui méprisait son côté narratif et de reportage. Les musées américains étaient contrôlés par des Conseils d’Administration dont les membres étaient, soit des barons voleurs désireux de justifier leur nouveau statut social en achetant des toiles de Maîtres anciens (ou d’impressionnistes à partir des années 20), soit des membres de l’élite sociale (« The Four Hundred « ) qui en possédaient déjà. [A de rares exceptions près comme William Ivins et Ananda Coomaraswamy], les directeurs de musée voyaient leur domaine comme étant incompatible avec les nouvelles pratiques culturelles qui, à l’extérieur des musées, attiraient des millions de personnes. Tant que les musées considéraient que leur raison d’être était la diffusion de la tradition culturelle gréco-romaine et que leurs déficits annuels pourraient être comblés en mendiant des subsides lors du Conseil d’Administration de décembre, ils n’avaient aucune raison d’ouvrir leurs portes à la racaille en montrant des films et des photographies.
L’art a changé, les musées ont changé, et les élites ont changé. D’abord aux Etats-Unis et, finalement aussi dans ce bastion de la culture qu’est la France, les musées se sont mis à allouer de plus en plus de place à la photographie. Une des raisons de ce changement fut évidemment économique : transporter, accrocher et présenter des photographies ne coûte pas cher, et les acheter coûtait moins cher que l’art traditionnel (même si c’est moins vrai aujourd’hui, avec les méga-tirages et leur méga-publicité). Mais la raison essentielle fut que les photographies attirent aujourd’hui des visiteurs de toutes les classes sociales, grâce à leur combinaison soignée de familiarité confortable, d’aperçu historique et de juste ce qu’il faut de déformation formelle pour paraître un peu différentes des souvenirs visuels bruts. Alors que personne ne veut rester plus de trois minutes devant une vidéo, on peut saisir une photographie en un instant : « Regarde ce drôle de garçon avec une grenade dans la main », « Ma mère avait des chaussures comme celles-là ». Pas besoin de s’approcher de près pour examiner des petites touches de cadmium rouge ou des traces de charbon. Dans un tirage photographique, tout ce qu’on voit, ce sont des pixels noirs ou, de plus en plus, les points tricolores d’une imprimante. En tant qu’objet, une photographie peut raconter une histoire vite et à bonne distance, et c’est ainsi que nous aimons recevoir nos messages aujourd’hui. […]
Les universités, avec leur habituelle léthargie institutionnelle, ont été en retard sur les musées, sur les collectionneurs et sur les marchands, mais elles aussi se sont mises à développer l’étude de la photographie dans un nombre étonnant de champs. Comme c’est un des seuls médiums visuels à avoir une vie extra-artistique, la photographie peut être étudiée à la fois comme populaire (dans les albums de famille, les journaux, la publicité, Facebook, etc.) et artistique : de la bonne nourriture pour les historiens, les anthropologues, les journalistes, les sociologues, les spécialistes en visual studies, les humanistes et les historiens d’art voulant échapper à l’accusation d’élitisme qu’on leur adresse si souvent. […] La photographie, étant un champ relativement sous-étudié, peut encore promettre à ses étudiants la probabilité d’une publication de leur thèse en livre (mais elle ne garantit toutefois pas à elle seule la nomination comme maître de conférences). […] Tous les artistes peuvent être photographes et tous les historiens d’art peuvent être historiens de la photographie, mais trop s’occuper des appareils photo, des objectifs et des produits de développement reste quand même un peu suspect. […]
Au risque de passer pour une disciple de Debord ou de Sontag, je suis un peu mal à l’aise avec cette fascination actuelle pour la photographie, qu’il s’agisse des tirages géants qui stupéfient les visiteurs des musées ou des photos de famille qui fascinent les historiens de la culture.
[Cet essai impertinent est de loin le plus intéressant de ce livre. Le seul autre essai que j’y ai vraiment apprécié est celui de José Luis Falconi, « Two Double Negatives » (p.130-147), sur l’incapacité de la photographie à avoir un rôle politique dans les luttes et procès contre les dictatures (en l’occurrence sud-américaines des années 70 et 80), et, en particulier, sur la manière dont les travaux d’Oscar Muñoz (Simulacros) et d’Alfredo Jaar (Rwanda Project) montrent l’impossibilté de montrer le crime.]
Illustration de mon choix, pas dans le livre.