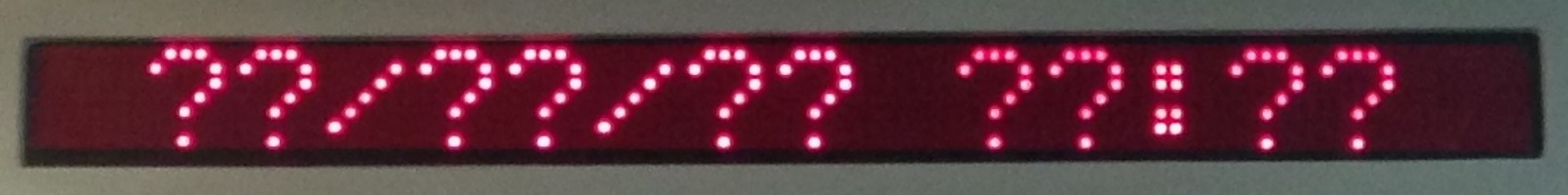« La plupart des femmes et des maîtresses des surréalistes nous demeurent inconnues. Qui a jamais entendu parler de Jacqueline Brauner ou de Simone Breton ? » écrit Xavière Gauthier dans son excellent livre Surréalisme et Sexualité (Gallimard, 1971), après avoir cité Dorothea Tanning (qui dit avoir compris trop tard « que son existence en tant que peintre devait inévitablement souffrir de par sa qualité d’épouse de Max Ernst. » Les seules femmes que la militante féministe Gauthier reconnaît comme véritables artistes sont Toyen, et Leonor Fini, qui a droit à la couverture de la première édition et à deux des vingt reproductions dans le texte (plus que Magritte, Miro ou Delvaux). Une exposition dans l’inattendu Musée de Montmartre (jusqu’au 10 septembre) tenterait-elle vraiment de prouver le contraire ? Elle a toutefois l’extrême prudence d’orner son titre d’un point d’interrogation : Surréalisme au féminin ?

En effet, les 45 artistes présentées ici (dont je confesse n’avoir connu qu’un tiers avant d’entrer dans l’exposition) ont des positions très diverses. Certaines, les plus connues, sont presque toujours qualifiées de surréalistes : Dora Maar, Lee Miller, Meret Oppenheim, Toyen, Valentine Hugo, la poétesse égyptienne Joyce Mansour (ci-dessus; au sujet de cette dernière, on ne peut que regretter la faiblesse de l’exposition sur les surréalistes égyptiennes, pourtant si importantes). D’autres ne furent guère que des épouses, des maîtresses ou des compagnes. D’autres passèrent plus ou moins vite par le surréalisme pour s’affirmer dans d’autres courants (Judith Reigl) et parfois nièrent avec la dernière véhémence avoir quoi que ce soit à voir avec ce mouvement (Leonora Carrington, Leonor Fini). Et la cinéaste Maya Deren, même si elle filma Duchamp, a toujours refusé toute affiliation avec les surréalistes, qui la méprisèrent en la comparant à Cocteau ; son film étrange (en haut), plein de rebonds, la voit ramper sur la plage puis sur une table, comme une annonce du Festin de Meret Oppenheim 15 ans plus tard. Quelques-unes enfin, toujours assez méconnues, sont de belles découvertes (et c’est plutôt d’elles que j’ai envie de parler ici). Tout comme la médiocre exposition sur les femmes et l’abstraction à Arles, cela ne fait pas vraiment un groupe ou un mouvement, mais s’inscrit plutôt dans une réécriture féministe de l’histoire de l’art (voir l’essai plutôt militant de Fabrice Flahutez dans le catalogue), même si les deux commissaires dénient sans beaucoup de conviction vouloir « emprunter des problématiques féministes contemporaines sur la relativité du genre dont elles seraient annonciatrices » (p. 15). Il faut donc citer Dorothea Tanning (p. 16) : « Les femmes artistes : une telle chose – ou personne – n’existe pas. C’est tout autant une contradiction dans les termes que « artiste homme » ou « artiste éléphant ». […] la place de la femme dans le surréalisme [n’est] pas différente de sa place dans la société bourgeoise en général. »

C’est plutôt une conjonction d’individualités, avec plus ou moins de distance par rapport à l’axe central (et à Breton, souvent). L’anglo-américaine Grace Pailthorpe, psychologue et adepte de la thérapie par l’art, fut pour cela marginalisée dans le mouvement : ses rêves étaient trop cliniques, pas assez décalés, comme sans doute celui-ci sur son accouchement d’un oeuf.

Mimi Parent, qui a droit à une notice spécifique dans le catalogue (p. 142-145), est une surréaliste tardive (post 1959), mais qui fut proche de Breton. Certains de ses objets plus ou moins érotiques ont une charge aussi forte que ceux de Meret Oppenheim : cette Maîtresse à double sens, post-surréaliste vu sa date, en est un bel exemple.

Une des révélations est sans doute celle qui orne aussi affiche et couverture du catalogue, alors qu’elle fut considérée comme subalterne par les papes du surréalisme belge. Jane Graverol, passa, sous l’influence de Magritte, d’un pur classicisme à un surréalisme érotique et débridé (mais toujours fort bien dessiné et peint, très lisse), où le temps est suspendu et l’acte ambigu.

Le catalogue est à l’image de l’exposition, un peu décousu. Après une très bonne présentation par les deux commissaires, trois coups de projecteurs très partiels sur la Grande-Bretagne, la Belgique et la Scandinavie, un essai assez médiocre sur les photographes, et quelques courtes notices individuelles. Il faut répondre non à la question du titre : il y eut bien des femmes surréalistes, mais il n’y eut pas de surréalisme féminin. Et si, comme le disent les commissaires « le surréalisme a offert aux femmes un cadre d’expression et de créativité », ce n’est pas, me semble-t-il « sans équivalent dans les mouvements d’avant-garde » : on peut penser que, dans ce champ, le constructivisme (et plus généralement les avant-gardes soviétiques) leur accorda une plus grande place. Ci-dessus, de la Brésilienne Maria Martins (qui fut amante et modèle de Duchamp), un petit guerrier bien masculin.