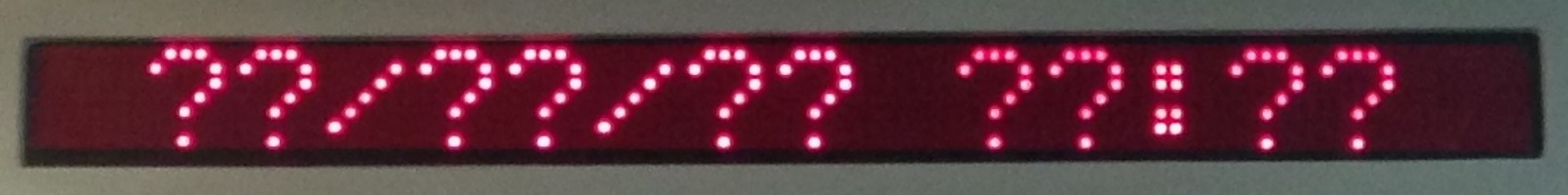La Kunsthalle de Düsseldorf présente (jusqu’au 17 février) une intéressante exposition où le travail cartographique, ou plutôt psycho-géographique de Öyvind Fahlström (mort en 1976 à 48 ans) et de Simon Evans (né en 1972) est mis en parallèle. Il s’agit ici de représentations du monde, d’un monde, de ses lois, de ses règles, des normes, des grilles et des diagrammes, d’un ordre en somme, et donc de la contestation de cet ordre. Alors que la contestation de Fahlström se situe plutôt dans le domaine politique et social (par exemple dans son World Trade Monopoly), celle d’Evans semble plus anarchiste, plus jouissive, plus situationniste aussi : c’est l’ensemble des règles de vie qu’il remet en question dans une pièce comme Shitty Heaven.
Là où Fahlström dessine des diagrammes labyrinthiques bien précis, conceptualisés et basés sur des faits, soigneusement légendés et avec des couleurs assez BD ou pop (par exemple Column n°4), Evans a un trait plus nerveux, plus désordonné, moins lisible (et, de toute manière, il faudrait une loupe et des heures pour tout lire) et plus souvent en noir et blanc (par exemple Life Garage Sale, ci-dessous); comme de plus il semble dyslexique, ses collages de mots s’insurgent contre le ‘capatalism’ ou nous exhortent à ‘brake the rules’. Et son humour décalé est percutant, à côté du plus sérieux Fahlström.
Fahlström crée des jeux, Monopoly et Domino : Guy Debord avait inventé un Jeu de la guerre (auquel on peut jouer ici). Le jeu aide à clarifier la pensée. De Debord, ce sont plutôt les dérives qui inspirent Evans (How to get lost).

Simon Evans, How to get lost, 2012, Foil from candy and cigarette packs, google map of Dusseldorf printout, paper, tape, pen, The Ella Fontanals-Cisneros Collection Miami, Fl.
De Fahlström, on voit aussi un jeu de souffle et de combat, Green Pool : flottant sur une cuvette d’eau verte, sept soldats et huit animaux sauvages sont prêts à s’affronter. Un léger souffle les projette les uns contre les autres.
En somme, chacun d’eux, en créant ses propres règles (de composition, de jeu ou d’orthographe), casse les règles que le monde voudrait lui imposer. Nos deux cartographes sont, chacun à sa manière, des libertaires dangereux pour l’ordre établi.

Yin Xiuzhen, Bookshelf No. 2, 2009, Clothes, wood, bookshelf, 226 x 126 x 43 cm, Courtesy of The Pace Gallery, Beijing

Yin Xiuzhen, Bookshelf No. 1, 2009, Clothes, wood, bookshelf, 226 x 126 x 43 cm, Courtesy of The Pace Gallery, Beijing
Le reste de la Kunsthalle est consacré (jusqu’au 10 mars) à l’artiste chinoise Yin Xiuzhen (dont on a pu voir à Paris les valises-villes) : de grandes installations spectaculaires souvent un peu trop évidentes, coeur rouge ou cerveau bleu géants faits de tissus. J’ai préféré ses pièces plus discrètes, plus ambiguës, comme ces étagères qui, d’un côté présentent la structure linéaire de dos de livres soigneusement rangés, et de l’autre un fouillis de vêtements froissés, ou comme sa série de photos de portes. Les performances éphémères qu’elle a réalisées dans la campagne chinoise, simplement documentées ici par des photos, semblent plus complexes, plus critiques, moins simplistes.
Photos courtoisie de la Kunsthalle, excepté la n°6 de l’auteur. Fahlström étant représenté par l’ADAGP, les photos de ses oeuvres ont été ôtées du blog au bout d’un mois.
Voyage à l’invitation de l’Office du Tourisme de Düsseldorf et de Thalys.