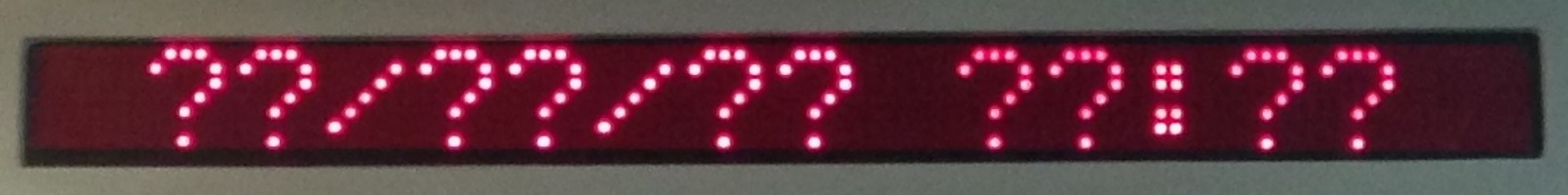Ce fut une usine d’alcool, puis de tabac, un édifice de pierre noire au bord de la mer. Des architectes de talent (eux et lui) en ont fait un musée tout à fait étonnant, mariant les vieilles pierres de lave avec des structures nouvelles tout aussi sombres en béton-basalte. Le centre d’art contemporain Arquipélago a ouvert ses portes il y a quelques mois; bibliothèque et espace de résidences sont encore un peu vides, la boutique a déjà un petit choix de livres d’architecture. L’espace théâtral Black Box est conçu selon une étonnante modularité, sans séparation entre scène et salle, entre acteurs et spectateurs; il m’évoque la vieille Schaubühne et aurait intéressé Bernard Blistène. L’ensemble, cube blanc cerné de noir, a à la fois une force indéniable et, disons, une forme d’humilité, de soumission aux œuvres (exposées ou performées), aux antipodes des musées de Frank Gehry par exemple.
L’exposition inaugurale (jusqu’à fin août) présente une sélection de pièces appartenant à la collection du Centre aux côtés de pièces prêtées par différents musées des Açores, autour du thème assez lâche du culte de l’Esprit Saint dans l’archipel, thème qu’on retrouve ici et là via des photographies et des objets historiques religieux ou laïcs liés à cette tradition. Dans le hall d’entrée, on est accueilli par cette œuvre de José Nuno da Câmara Pereira qui semble faite elle aussi de pierre volcanique, sable noir dans lequel s’inscrit la gestuelle du peintre (Fogo frio / Terra de lava) comme un raccourci de la géologie de l’île transformée par la main de l’artiste.
Suivent quelques pièces plus conceptuelles, dont la meilleure est sans doute cet arc-en-ciel de Bruno Pacheco, caisses de transport d’œuvres d’art enchâssées les unes dans les autres, avec leurs couvercles apposés au mur : là où l’arc-en-ciel touche le sol on trouve un pot d’or, ici sont les trésors. A côté, une belle sculpture murale très épurée de l’Argentin Nicolas Robbio, toute en tension et en équilibre.
Une salle suivante rassemble des pièces plus en rapport avec le monde : au centre, un radeau en toile de jeans de Pedro Valdez Cardoso, métaphore touristique et migratoire. Aux murs, de belles photographies de lieux vides, aux corps absents, par Catarina Botelho, et des Unes de journaux aux titres accrocheurs, faits en patchwork, par le Sud-Africain Lawrence Lemaoana.
Sur un autre mur, une longue litanie de petites photographies du Burkinabé Saïdou Dicko qui traque et récolte les ombres, vraies ou fausses, les silhouettes, les fantômes, et la manière dont ils occupent et marquent un territoire.
Les cellules au sous-sol combinent objets traditionnels et œuvres contemporaines. Dans une longue liste, j’ai retenu une vidéo de Rui Calçada Bastos montrant l’intérieur d’un vieux wagon avec le paysage défilant dans deux sens opposés (comme un pied de nez à la théorie de la relativité, ou un écho du jeune homme triste); et une autre vidéo de José Maçãs de Carvalho dont la main efface méticuleusement une photographie de Helmut Newton : la vidéo comme outil de destruction des images iconiques, aboutissement d’une réflexion complexe sur les images et la culture visuelle. Au bout d’un couloir, cette composition diaphane d’Ana Vieira, une fleur et son ombre portée flottant dans la gaze (d’elle aussi, à l’étage, cette vidéo stimulante).
Enfin, à côté de deux belles vidéos de Filipa César autour des salines de Castro Marim (l’une toute de sensualité gourmande, l’autre, plan fixe de ce mont de sel de l’aube au crépuscule, habitée par des récits sur la normalisation, la déportation, l’exil), j’ai fini ma visite avec cette vidéo absurde et drôle de Joao Onofre : comment maintenir un niveau à bulle horizontal pendant une chute libre en parachute. Un impossible équilibre ? En anglais, niveau à bulle se dit « spirit level » : on revient à l’esprit (saint)…
Au bout de ce parcours intéressant mais un peu décousu, et dont le sens global peine à émerger, au delà d’un panorama de la création contemporaine (surtout portugaise et lusophone : 30 des 35 artistes présentés) telle que représentée dans cette collection, on reste sous le charme de ce bâtiment encore peuplé de fantômes, et on se prend à rêver à des expositions qui sauraient entrer davantage en résonance avec ce cube blanc de pierre noire, comme Walk & Talk entre en résonance avec l’île et sa culture populaire.
Le même commissaire, João Silvério, présente aussi une petite exposition collective dans la seule galerie de l’île, Fonseca Macedo, qui fête ses quinze ans. Parmi les pièces présentées, la photo d’un fauteuil percé avec la bourre sortant de la fente, par Ana Vieira, deux dessins « de plage » de Pedro Cabrita Reis, une accumulation de bateaux en papier par Catarina Branco (dont les découpages de papier dans Arquipélago sont fascinants), et surtout une remarquable vidéo de Susana Mendes Silva montrant la main de l’artiste écrivant et réécrivant au crayon sur une feuille de papier ligné la phrase « my obsession leads to compulsion ». Passant et repassant sur les lettres avec une énergie inépuisable, elle se confronte à la feuille, la troue et la déchire : cet acharnement, cette obsession-compulsion mènent à la destruction, et peut-être, alors, à l’apaisement…
Voyage à l’invitation du festival Walk & Talk.
Photos de l’auteur excepté 1&2