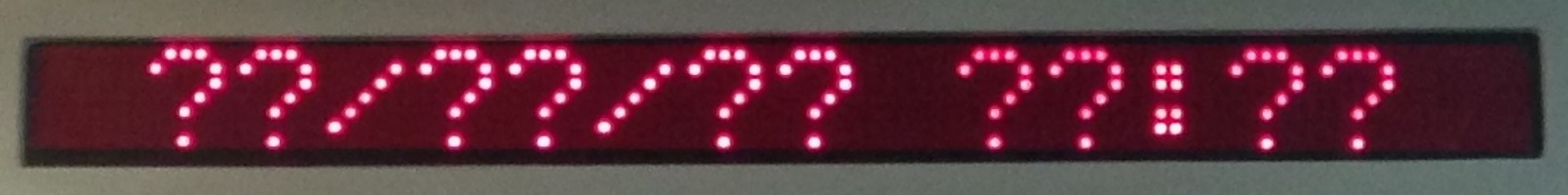Cildo Meireles, Desvio para o vermelho II Entorno, 1967 1984
en espagnol
in English
Soudain l’asphalte se fait plus doux sous les roues de notre voiture, la route est moins défoncée, plus de lombadas intempestives (gendarme couché en portugais du Brésil); il n’y a plus de maisons mi en ruine mi en construction, plus d’urbanisme totalement anarchique, plus d’annonces pour diseuses de bonne aventure ou églises évangéliques, plus de gamins courant en tous sens. Soudain, une fois passés les gardes armés à l’entrée, on se retrouve dans un autre Brésil, sans chaos, sans pauvreté, sans désordre, sans corruption (enfin, presque), un Brésil riche, apaisé, serein, le contraire du Brésil quotidien, réel : ici, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Bienvenue à Inhotim. Cet ensemble de 2000 hectares au centre du pays est avant tout un immense jardin (Libé avait titré son article « Collection d’hectares contemporains ») dans lequel sont implantés des bâtiments hébergeant des œuvres d’art, et des sculptures en plein air, c’est le plus grand musée à ciel ouvert du continent, voire du monde, c’est l’accomplissement du rêve mégalomaniaque d’un homme d’affaires autodidacte au franc-parler et à la réputation quelque peu sulfureuse, Bernardo Paz, enrichi par l’exploitation intensive des mines de la région et qui dit lui-même « Je n’ai pas de passion pour l’art; mais j’aime les jardins » et « Je ne comprends pas l’art, je ne comprends pas Picasso. »

Matthew Barney, De lama lamina, 2009
Outre la taille démesurée du site, ce qui est impressionnant ici est la possibilité de voir des installations de très grande taille, qui, d’ordinaire, une fois montrées, finissent démontées dans des réserves; certaines ont d’ailleurs été conçues spécifiquement pour ce lieu. 22 sculptures de grande taille en plein air, 17 galeries dédiées chacune à un seul artiste et six autres pour des expositions collectives, le tout réparti et mis en scène dans toute la fazenda, il faut bien deux jours au moins pour tout voir (1), et plus si on s’intéresse aussi aux 1400 variétés de palmiers et autres profusions botaniques. N’oublions pas, 1000 employés, pour la plupart recrutés localement, soit environ un par visiteur quotidien. Que ressort-il de cet ensemble ? Une collection contemporaine assez disparate, 50% brésilienne, 50% du reste du monde. Presque uniquement des grands noms, pas beaucoup d’audace ou de prise de risque (par exemple, alors que le directeur d’Inhotim est le curateur de l’actuelle Biennale, aucun artiste en commun, sauf erreur : un univers différent, ici la consécration, là-bas l’innovation); des 80 et quelques artistes du catalogue, seuls quatre ont moins de 40 ans (dont Dominik Lang, 36 ans, sur qui je reviendrai, une de mes seules découvertes de poids ici).

Cildo Meireles, Atraves, 1983 1989
Avant de parler dans un prochain billet des pièces les plus impressionnantes, je voudrai d’abord ici montrer comment, dans cet univers si préservé, si éloigné de la complexité du pays, celle-ci, grâce aux artistes, peut soudain faire irruption et refaire prendre pied dans le réel. L’image tout en haut est tout au bout d’une installation de Cildo Meireles (déjà vue ici), Desvio para o vermelho: Impregnação & Entorno, où tout est rouge : au bout, une petite bouteille répand un immense flot rouge au sol, sang des victimes ou pollution minière, et un filet s’écoule d’un robinet. Du même, l’installation Atraves (ci-dessus), pour laquelle je reprends mon texte de 2009 : « Through (À travers) est une immense installation qu’on doit décrire en trois temps : d’abord, sous nos pieds, le verre pilé que nous écrasons bruyamment à chaque pas, détruisant encore plus l’oeuvre de manière, je l’avoue, assez jouissive (mais, d’abord, seul dans la salle, je n’ose pas, je demande la permission au gardien). On ressent le danger, on transgresse un interdit, on brise des contraintes. Ensuite, devant nous, des barrières transparentes, organisées en six carrés homothétiques, bloquent ma voie, mais pas ma vue; ce sont des barrières, des claies, des rideaux de perles, des stores, des grillages, des rideaux de douche, des barbelés, des panneaux de verre et des aquariums où même les poissons sont transparents. Et le spectateur tente d’avancer dans ce faux labyrinthe, contourne, évite, navigue entre les obstacles, tout en pilant joyeusement le verre au sol. Enfin, au centre, violemment éclairée, une énorme boule de cellophane froissée, d’un rayon d’au moins un mètre, est devenue opaque du fait de sa densité; on imagine les crissements, la symphonie qui a dû accompagner sa construction, son froissement. C’est l’idole dans son saint des saints, l’arche sacrée vers laquelle nous tentions de progresser, mais que nous ne pouvons approcher davantage, soleil blanc, métaphore de l’univers. On vient d’expérimenter le permis et l’interdit, le oui du gardien et le non des barrières, l’écart entre le regard, libre, et le toucher, contraint, et on se retrouve face à une vérité insaisissable, mystique. »

Chelpa Ferro, Jungle Jam, 2016
Tout aussi perturbante (deuxième image ci-dessus) est la pièce De Lama Lâmina, de Matthew Barney installée dans un pavillon géodésique perdu dans la forêt : un énorme tracteur utilisé pour défoncer la terre dans les exploitations minières tient entre ses griffes un arbre arraché. Même si l’allusion aux orixás ne paraît pas évidente, on peut voir aussi là une évocation du passé minier du maître des lieux. On retrouve une dimension critique dans l’installation Jungle Jam de l’insolent trio Chelpa Ferro (une belle découverte), dans laquelle de banals sacs en plastique de supermarchés sont les éléments d’une symphonie de gonflements, de crissements, de claquements, d’expirations et d’éclatements, comme un contrepoint consumériste à la pièce de Janet Cardiff.

Chris Burden, Beam Drop Inhotim, 2008
Un autre lieu où nous sommes rattrapés par le chaos est, dans les hauteurs du parc, une sculpture de Chris Burden (dont, par ailleurs, une salle documente les performances), Beam Drop Inhotim : c’est la trace d’une performance durant laquelle, pendant douze heures, du haut d’une grue de 45 mètres, l’artiste a lâché 71 poutrelles de fer dans une cavité pleine de ciment liquide. Les poutres se sont plantées dans le ciment avec des inclinaisons et des profondeurs diverses, l’ensemble est parfaitement chaotique, empreint d’une violence maîtrisée : en écho, on voit, au loin, la ville voisine, et cette sculpture est comme un rappel de ce désordre lointain, tenu à distance mais impossible à ignorer. Plus haut Burden a installé un bunker-mirador fait de sacs de ciment, faussement dénommé rucher, mais nulle abeille ne saurait faire son miel dans cet instrument de surveillance et de répression au dessus de la ville de poutrelles.

Carlos Garaicoa, Ahora juguemos a desaparecer II, 2002
Même si divers cabinets d’architectes ont travaillé à Inhotim (l’essentiel du guide de visite leur est consacré), on retrouve des traits communs dans la grande majorité des pavillons, par ailleurs splendides : un aspect de bunker, fermé, obtus, sans fenêtres, dans lequel on pénètre par des couloirs sombres s’enfonçant dans la terre ou dans le bâtiment, et où, après une chicane, on découvre soudain l’oeuvre dans toute sa splendeur, comme dans un saint des saints où l’éclat de l’idole soudain révélée doit déclencher l’admiration. Seuls les pavillons de Tonga, ouverts vers l’extérieur et la forêt, et celui de Doug Aitken, conçu spécifiquement par l’artiste et non par un architecte, échappent à cette norme de mise en scène d’une découverte émerveillée. Mais deux artistes critiquent cette architecture encadrée et aseptisée : d’abord Carlos Garaicoa qui, dans une ancienne grange tout aussi obscure, détruit par le feu des immeubles de cire, lente évolution vers la ruine et regard désespéré sur l’architecture (Ahora juguemos a desaparecer).

Cristina Iglesias, Vegetation Room Inhotim, 2010 2011
Et ensuite le pavillon de Cristina Iglesias, Vegetation Room Inhotim, perdu dans la forêt au bout d’un sentier : ses parois sont des miroirs reflétant les arbres alentour, il est de ce fait à peine visible, un simple écho de son environnement. Ses parois sont percées de trois ouvertures par lesquelles on peut pénétrer dans une fausse forêt intérieure de résine et de fibre de verre, d’un vert maladif et triste : merveilleuse opposition entre nature et culture, entre modèle et imitation, entre vérité et représentation, critique de l’art et art de la critique. Des œuvres réjouissantes dans cet univers trop consensuel.
(1) Pour être précis, je n’ai pu voir trois galeries, Doris Salcedo (fermée), Valeska Soares et Claudia Andujar, faute de temps.
Photos Meireles, Iglesias et Burden de l’auteur