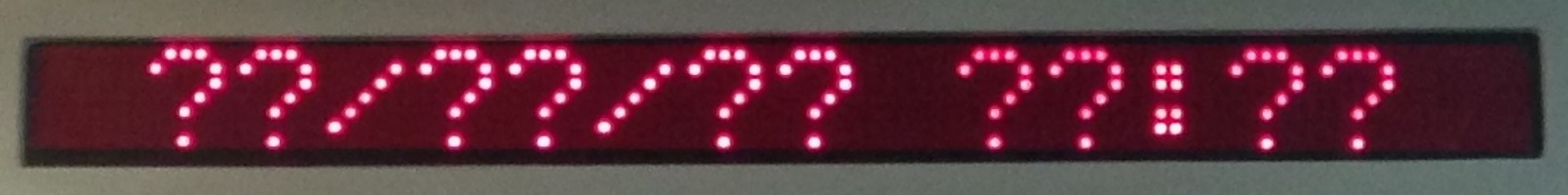Francis Alÿs, Sans titre (Migrant / Tourist), 2007-08, crayon, peinture à l’huile et ruban à masquer sur papier calque
L’exposition « Notre monde brûle » au Palais de Tokyo (jusqu’au 17 mai), conçue par Abdellah Karroum, directeur du Mathaf, me réconcilie avec ce lieu, dont la programmation est, à mes yeux, trop souvent, à la mode, ésotérique et coupée du monde. Oui, notre monde brûle, au propre (Australie, Amazonie, …) comme au figuré (migrants, dénis de démocratie, …) et nous tentons, à tâtons, en désordre, d’y résister (combats écologiques, printemps arabes, luttes pour la justice sociale, prises de conscience postcoloniales, …), sans nous laisser distraire par de vains épouvantails (faites votre choix, il en est tant). Cette exposition inclut 34 artistes, la plupart (28) venant du (ou liés au) monde arabe (20 : Maroc, Egypte, Algérie, Qatar, …) ou musulman (Turquie, Iran), ou de pays du Sud (Inde, Viet-Nam, Ghana, Nigéria, Congo). Mais j’ai souhaité démarrer avec Francis Alÿs, belgo-mexicain et citoyen du monde, qui évoque dans le catalogue son expérience en 2016 avec un bataillon kurde dans le nord de l’Irak, et qui propose ici une pièce très réflexive sur les divisions, les oppositions, les frontières. Peut-être est-ce de ces schémas qu’il nous faut partir pour savoir de quel côté nous sommes, pour distinguer l’essentiel du secondaire et pour nous préparer au combat. Ce sont une vingtaine de peintures cartographiques sur papier calque, disposées sur une table rétroéclairée comme pour un briefing de campagne, toutes composées d’une terre jaune, d’une terre verte, et d’un océan bleu qui les entoure; et sur chacune, est inscrit un doublon : Known / Unknown, Open / Closed, Leave / Return, Us / Them, Real / Imaginary, Migrant / Tourist. Les migrations et les frontières, certes, sujet dont il est familier, mais aussi la complexité du monde, les exclusions et les différences.

Monira al Qadiri, OR-BIT, 2016, sculpture en impression 3D en lévitation, 20x30x20cm (à l’arrière plan : Sammy Baloji, ST, 2018, douilles d’obus et plantes d’intérieur)
Autre oeuvre induisant réflexion, celle de la Koweitienne Monira al Qadiri, qui réalise des bijoux pétroliers faits de perles iridescentes; celle-ci lévite au-dessus de son socle. Venant d’un pays dont l’économie a connu une folle croissance depuis un demi-siècle, l’artiste, consciente des enjeux écologiques et politiques, propose des oeuvres à la fois ancrées dans l’histoire et visionnaires, un questionnement de la folie de pouvoir et de richesse qui s’est emparée de notre monde. J’ai d’ailleurs été frappé par la qualité des artistes venant du Golfe dans cette exposition, trop peu connus en Occident : outre cette Koweitienne, il y a trois Qataris, Bouthayna al Muftah et ses performances calligraphiques historiques, Sophia al Maria et son tétrapode de science-fiction, et, seul homme du lot, Faraj Daham et ses portraits de travailleurs immigrés. Contrairement aux idées reçues (ou colportées) sur leur pays (par ailleurs patrie d’Al Jazeera et en butte à l’hostilité de ses voisins saoudien et émirati), ils n’hésitent pas à en questionner la structure sociale et les mécanismes de pouvoir.

Asli Çavuşoğlu, Le lieu de la pierre (détail), 2018, fresque sur panneau en aerolam, 125x125cm chacun
L’histoire est, pour plusieurs artistes, le moteur même de leur travail. Ainsi l’artiste turque Asli Çavuşoğlu revisite l’histoire du lapis-lazuli, minerai bleu venant d’Afghanistan, de la mine Sar-e Sang, c’est-à-dire le lieu de la pierre, pigment précieux dans l’histoire de la peinture jusqu’au début du XIXe siècle (et, plus récemment, source de richesse pour les Talibans). Bleu négligé dans l’Antiquité, bleu marial et royal à partir du milieu du Moyen-Âge, bleu moral de la Réforme, bleu horizon, bleu du drapeau européen (il faut relire Pastoureau), bleu Klein (évoqué ici par de discrètes anthropométries), la grande fresque de Çavuşoğlu décline cette archéologie du bleu.

Amina Menia, Foot de Libération Nationale, 2019, installation vidéo et diapo sur 3 écrans, capture d’écran partielle
Voici une pièce qui m’est chère, pour des raisons toutes personnelles : jeune Stéphanois de dix ans un peu footeux, j’avais vécu comme un coup de tonnerre la disparition de Rachid Mekhloufi de l’ASSE et sa réapparition quelques jours plus tard comme capitaine de l’équipe du FLN. L’artiste algérienne Amina Menia a interviewé Mekhloufi, et, en parallèle, l’écrivain Slimane Zeghidour ; avec quelques photos d’époque, elle présente son installation Foot de Libération Nationale : le football comme élan populaire et outil de cohésion, d’appartenance, comme instrument de création d’un mythe national, comme échappatoire social. Une oeuvre documentaire et questionnante, simple, mais forte.
Michael Rakowitz, dont la mère est Irakienne, a beaucoup travaillé sur le pillage et l’appropriation, en particulier lors de l’invasion de l’Irak par les Américains. Il a reconstitué ici des objets d’art des musées syriens et irakiens qui ont été volés ou détruits; ces objets sont faits avec des emballages alimentaires et du papier journal, mêlant copie, simulacre et, en quelque sorte, arte povera. Ce questionnement autour du pillage des oeuvres d’art, ici représenté de manière visuellement frappante, rejoint les réflexions d’Ariella Aïsha Azoulay que je relatais il y a peu.
Une des pièces les plus dérangeantes ici est celle d’Amal Kenawy (artiste égyptienne décédée en 2012, dont je parlais en 2008) qui, outre une maison faite de bonbonnes de gaz dans laquelle on pénètre avec un peu d’appréhension, montre une vidéo, Silence of the Sheep, où elle fait ramper une vingtaine d’hommes dans les rues du Caire : elle se fait interpeller par des Cairotes à plusieurs titres, comme femme commandant à des hommes rampants, comme bourgeoise payant des prolétaires pour ramper, comme artiste faisant un art incompréhensible au commun des mortels, et comme Egyptienne donnant une mauvaise image de son pays. Et tout cela n’est pas si faux … Seule autre artiste décédée ici, égyptienne elle aussi, la merveilleuse peintre Inji Efflatoun, emprisonnée quatre ans sous Nasser, et sa mariée libanaise au fusil.

Bady Dalloul, A Country Without a Door or a Window, 2016-2019, détail d’une série de 200 dessins au stylo noir, feutre et crayon de couleur sur bristol, encadrés dans des boîtes d’allumettes, chacun 4.1×2.7cm
Bien d’autres oeuvres encore : des photographies d’Egyptiens par Shirin Neshat, des portraits de réfugiés syriens par Mounira al Solh, des petits dessins de réfugiés dans des boîtes d’allumettes par Bady Dalloul, des fragments de la Statue de la Liberté par Danh Vo, une installation vidéo sur six écrans de John Akomfrah (vue à Berardo il y a peu), des câblages de Mounir Fatmi, des fleurs dans des douilles d’obus par Sammy Baloji, les souffles mystiques de Younes Rahmoun, l’oeuvre brute de Khalil el Ghrib, les machines solaires d’Yto Barrada, et l’installation spectaculaire de Wael Shawky occupant tout le sous-sol. Quelques bémols : une fois de plus Kader Attia ne s’est pas foulé, avec une pyrogravure de croissants musulmans et d’étoiles de David, simpliste et bâclée; et on se demande vraiment ce que la maison autonettoyante de Dominique Hurth vient faire ici : rien à voir avec la thématique, et, s’il faut faire preuve de féminisme, les 15 autres artistes femmes ici présentes l’ont fait de manière bien plus pertinente et intelligente. A noter que le catalogue, outre la présentation des oeuvres, comprend un petit texte de la plupart (24) des artistes exprimant leur réaction au monde qui brûle, certains de manière très émouvante.
Inspiré par cette exposition revigorante, on peut ensuite aller voir la salle dédiée à Nicolas Daubanes (lauréat du Prix des Amis) : révolte, enfermement, résistance, dessins communards à la limaille de fer, poèmes d’Akhenaton, et une petite guillotine à la lame faite de dents. Par contre, on peut passer vite chez Kevin Rouillard (lauréat du Prix SAM), assez banal. Quant à Ulla von Brandenburg, seule l’entrée vaut la peine, en traversant les tentures percées d’un trou circulaire; le reste, et en particulier son film, est assez ennuyeux, creux et décevant, par rapport à ce qu’elle avait montré précédemment au Prix Marcel Duchamp et à Villeurbanne. La malédiction du PalTok ?
Photos de l’auteur excepté les n° 2 & 6.