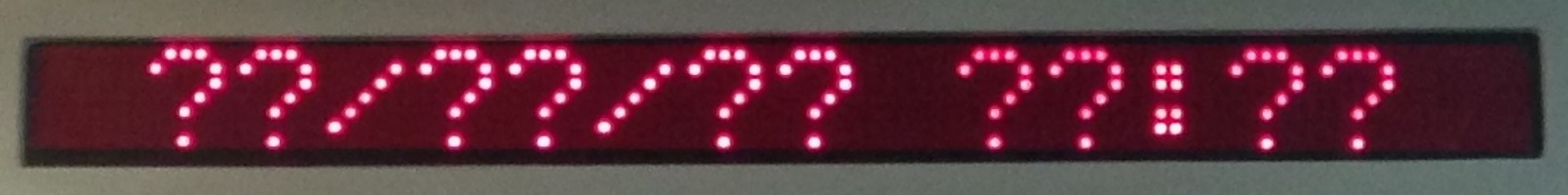J’avais vu cet été une présentation des quatre artistes sélectionnés pour le Prix Marcel Duchamp cette année et j’avais alors émis une première opinion. J’ai vu leur exposition à la FIAC et écouté les présentations au jury du travail de chacun qui viennent d’être faites. Allais-je changer d’avis ?
Je reste (hélas ?) toujours insensible au travail de Valérie Favre. Philippe Dagen a beau en faire l’éloge, je reste froid. Lui accorder le prix serait, à mes yeux, une décision éminemment politique : couronner une femme peintre, comme le fut Carole Benzaken en 2004 (un des prix les plus faiblards avec celui de Cyprien Gaillard).
J’ai été assez déçu par la proposition de Franck Scurti : ce qui me plaisait dans son travail précédent (comme je l’écrivais cet été), c’était son irrévérence, son humour, sa discrète mise en cause de notre monde consommateur (les enseignes) ou financier (La linea), les heurts qu’il créait entre fiction et réalité, entre idéal et prosaïsme. Mais, sur le stand de la FIAC, rien de tout cela, l’accent est mis sur la ‘rédemption’ du matériau de récupération pour créer des formes assez banales (ici le serpent et la pomme), trop allégoriques pour être vraiment poétiques. Je n’ai pas été séduit, malgré les explications de Jean de Loisy.
J’ai d’abord pensé voter pour Bertrand Lamarche, le moins connu des quatre, peut-être le plus pur et le plus exigeant. Après l’échantillon diversifié de son travail montré cet été, il propose ici une veduta, une maquette du site ferroviaire de Nancy dont, depuis longtemps il admire la pureté des formes; mais c’est une vue qui n’est plus, victime du remaniement urbain, une vue nostalgique et réinventée. De ce réel, il fait une fiction, modifiant les bâtiments (le principal, dû au fils Prouvé, fait vaguement penser à Beaubourg), mais surtout, passant par le biais d’une mini-caméra et d’un tunnel rotatif en plexiglas, il projette sur l’écran une vision fantomatique du site, flottante, onirique, un peu inquiétante, ‘unheimlich’. Mais j’ai regretté ici un quasi abandon du son et de la boucle interactive (qui me semblait être sa marque la plus distinctive), au profit d’une approche très réfléchie sur l’architecture, soulignée par la philosophe Antonia Birnbaum qui l’a présenté au jury. Le fait que l’interaction entre son, mouvement et image soit ici fort amaigrie (à la différence de sa pièce Réplique, visible au Museum d’Histoire Naturelle pendant la FIAC) ajoute une sécheresse malvenue à son travail, que j’avais au contraire trouvé exubérant précédemment, une intellectualisation froide là où je l’avais trouvé sensible et créatif. J’aurais néanmoins ‘voté’ pour lui s’il n’y avait pas eu Dorothée Dupuis.
Dorothée qui ? Cette jeune curatrice que je connais depuis les débuts du Commissariat et qui, jusqu’il y a peu, officiait à Marseille, a présenté, un peu au pied levé (remplaçant une parturiente) le travail de Dewar et Gicquel. Je n’avais pas une passion pour ces deux-là : trop d’emphase sur l’artisanat, sur le travail bien fait de leurs propres mains, trop de souci de la figuration, je trouvais cela un peu superficiel. La pièce montrée à la FIAC est séduisante : un gisant de pierre sombre (dolérite) commandé par un collectionneur pour son tombeau futur, représentant un plongeur androgyne (je présume assez peu ressemblant au commanditaire) muni de palmes. C’est une proposition qui plaît d’emblée, s’inscrivant ainsi dans l’univers des collectionneurs (c’est l’ADIAF qui organise le prix) tout en prenant ses distances l’air de rien. Je me suis d’abord dit que cette pièce était justement un peu trop séduisante, voire un peu ‘marketing’.
Et puis, hier, sur le stand d’Hervé Loevenbruck à la FIAC, j’ai vu leur petit film en six images, Le Menuet, six fois une grande statue d’argile qu’ils font, photographient, puis défont, puis refont dans une pose différente, six pas de menuet dansés par un homme nu sans bras ni tête, six poses sculpturales; quand on les regarde en .gif ou qu’on utilise le catalogue comme un flipbook, le corps s’anime, les jambes bougent, la danse se met en place. C’est là une réinvention du film, de l’image en mouvement, à partir d’images fixes, mais au prix d’un labeur énorme de sculpture pour chaque image; et tout cela est éphémère. Tiens, me suis-je dit, je devrais m’intéresser davantage à leur travail.
Et puis, lors de cette présentation au jury du Prix (qui, au moment où j’écris, délibère en secret), Dorothée Dupuis s’est mise à parler; c’était déjà suffisamment différent dans la forme des autres présentations compassées pour que, malgré le moment postprandial, chacun prête attention. Mais ce fut surtout un éclairage de leur travail à la lumière de l’histoire de l’art (‘Bonjour Monsieur Courbet’ inclus), y compris de l’art non-occidental, et de l’artisanat, des ‘Crafts’, ce fut un éloge de la réapparition de la forme au milieu de rien, un plaidoyer pour le retour au concret face aux incertitudes du monde, un discours éclairé, historié et décapant qui n’a laissé personne indifférent.
Alors voilà, je ne m’y attendais pas, mais j’ai changé d’avis. Je ne sais si le jury votera aussi Dorothée Dup, oh, pardon, je veux dire Dewar & Gicquel; nous verrons, résultat samedi à 11h.
[Et ce sont donc Dewar & Gicquel qui ont obtenu le prix. Comme quoi la présentation d’un travail n’est pas sans importance; peut-être que tous les mauvais et conformistes écrivaillons de la critique (ce qui, je le précise, ne concerne aucunement les trois autres présentateurs, tous trois personnes de qualité) en prendront une leçon.]
Photos de l’auteur. Franck Scurti étant représenté par l’ADAGP, la photo de sa pièce a été ôtée du blog au bout d’un mois.