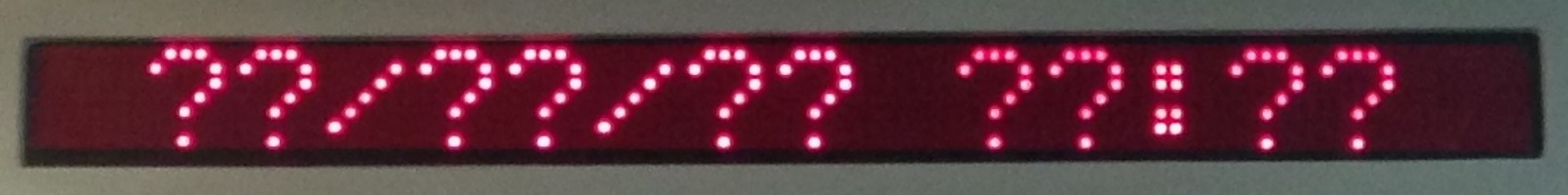10 billets ce mois-ci
1er février : À propos de Zineb Sedira représentant la France à la Biennale de Venise et du BDS
5 février : Whose Place? (Israël Palestine)
9 février : Kirchner, génie et ambiguïtés
17 février : Au supermarché (des images)
18 février : Du Viol, des viols (Laia Abril)
19 février : L’inatteignable (Taysir Batniji)
20 février : Quelle photographie pour les Yanomami ? (Claudia Andujar)
21 février : Unica Zürn, identité propre et réalité singulière, envers et contre tout
24 février : Globales et diverses, les villes sombres d’Andreas Bitesnich
27 février : L’énergie de la matière (Joana Escoval)
Livres reçus (hors catalogues d’exposition critiquées)
Helga Paris, Leipzig Hauptbahnhof 1981/82, Spector Books, 2020, 144 pages, dont 114 pages de photographies (77) en noir et blanc de la gare centrale de Leipzig, en lien avec une exposition de Helga Paris à l’Akademie der Künste à Berlin. Texte essentiellement documentaire de Inka Shube en allemand et en anglais . En 1981, c’est encore la RDA et on voit dans ces photographies des voyageurs, des employés (leur dignité impressionne), un peu de l’architecture (impressionnante, majestueuse) et, très peu, des trains. La nostalgie d’un temps plus calme, semble-t-il, comme gelé. Ce qui est curieux, c’est que Helga Paris avait oublié ces photographies et vient de les redécouvrir prés de 40 ans plus tard pour son exposition berlinoise : acte manqué ?
Lubaina Himid, Éditions du New Museum, 2019, 176 pages (dont 127 pages de reproductions en couleur et 6 en N&B), à l’occasion de son exposition au New Museum à New York. Textes en anglais de Jessica Bell Brown et de Fred Moten, entretien avec l’artiste de Natalie Bell, commissaire de l’exposition. Lubaina Himid est une peintre britannique originaire de Zanzibar, lauréate du Turner Prize en 2017 et exposée en France seulement au CAPC, tout récemment. Son travail est centré sur son identité noire et sur l’histoire des Noirs et de l’esclavage. Plusieurs types de travaux dans ce livre : des tableaux de style un peu naïf agrémentés de textes subtilement politiques, des portraits trés frontaux, directs d’hommes et de femmes noirs (parfois insérés dans des tiroirs), des scénes de genre, des toiles géométriques quasi abstraites, et aussi des céramiques, des installations. Un travail ouvertement engagé et souvent très fort, que, en particulier, son interview explicite bien.
Philippe Guiguet Bologne, Ce qui nous restera [Fragments de Tanger et d’ailleurs …], Scribest, 2019, 156 pages. Ce récit poétique est un cheminement dans un dédale, une dérive dans laquelle le lecteur peut « être sujet à un étourdissement dans le vertige des lignes qui s’entrecoupent » face aux « empâtements,contre-poinçons, boucles et ligatures des caractères »; comme dans un tableau de Escher (évoqué comme Maurits Cornelis à maintes reprises), on tangue entre récits entrecroisés, typographies variables, vocabulaire précieux et citations multilingues, se raccrochant au style somptueux et aux fenêtres ouvertes sur l’art, le cinéma, la littérature, le monde. On balance entre Tanger (« fracassé par le manque d’amour »), où vit l’auteur, et la Palestine, où il fut attaché culturel, Palestine mythique du colibri de Khaled Jarrar, tourmentée par des démons pleins de vaine haine, avec aussi un dessin, Absence, d’un artiste du Golan occupé, Fahed Halabi. Les personnages qui traversent ces chemins sont des hommes jeunes et beaux, entre bad boys, rappeur coranique et pêcheurs tangérois, et aussi Hiérophante et ses compagnons feddayin « qui aiment plus que tout la poésie et le combat, les femmes et les parfums, la prière et la justice », et, plus concrets, l’artiste lisboète Tomas Colaço et ses anecdotes, et El, femme fatale et tragique. De l’art, partout : l’auteur entre dans des toiles de Matisse pour la compagnie des odalisques, ou parfois d’une liseuse ou d’un goumier; Jean-Luc Godard passe comme un fantôme (et une photographie de Mustapha Abou Ali le montre venu tourner Ici et Ailleurs dans un camp de réfugiés en Jordanie); Pasolini le croise au fil des pages et Ernest Pignon-Ernest (avec qui l’auteur réalisa un certain exploit) le montre mort et vivant, portant son propre cadavre. Beaucoup de références à la peinture classique, que Philippe Guiguet Bologne connaît bien et regarde avec passion et talent, Zurbaran (Saint Sérapion), Sint Jans (Jean-Baptiste), Bellini (Pieta de Brera), Botticelli (Pallas), Enguerrand Quarton (Pieta), et d’autres, et semble-t-il, un désamour pince-sans-rire du travail récent de la tangéroise Yto Barrada, devenu à ses yeux trop réductible à un discours marchand, alors que ses photographies anciennes de Tanger l’emplissent de mélancolie. Mélancolie omniprésente dans ce livre, mais étrangement joyeuse, comme Eurydice qui, percevant qu’Orphée va se retourner, est « profondément bouleversée, d’un bonheur et d’un soulagement qui frôlèrent l’ivresse ». Un peu ce que nous pouvons ressentir en entrant dans ce livre comme l’auteur entre dans les toiles de Matisse.