
L’exposition « À partir d’elle » au BAL (jusqu’au 25 février) est consacrée au rapport que des artistes et écrivains ont avec leur mère (dont le nom de jeune fille, en général inconnu, est listé en 4ème de couverture). Parmi ces 26 oeuvres et écrits, les plus forts sont indubitablement ceux des orphelins, ou plutôt (à l’exception de Roland Barthes et de son fameux texte – reproduit au mur – dans La Chambre Claire sur la photographie de sa mère comme outil surérogatoire), des orphelines. Il y a là la Japonaise Ishiushi Miyako photographiant des objets de sa défunte mère, une image fantomatique d’Hélène Delprat, les fameuses photographies dédoublées de la Sud-Africaine Lebohang Kganye, le périple de Sophie Calle allant déposer sur la banquise le collier (Chanel, bien sûr), le diamant et une photo de sa mère. Mais, de toutes, l’œuvre la plus poignante est celle de Rebekka Deubner. Que faire des vêtements d’une morte ? Ils portent encore son odeur, ont encore l’empreinte de son corps, la trace de ses formes : faut-il les brûler ? les jeter, les donner ? Rebekka Deubner fait son deuil en se les appropriant, de deux manières. Elle les porte, elle s’en enveloppe en les accumulant sur elle jusqu’à l’outrance. Une vidéo (rapiécer) la montre d’abord nue, comme au jour de sa naissance, fixant l’objectif d’un regard fixe, halluciné et plein de tristesse, de mélancolie ; après un long moment d’attente, d’incertitude, elle enfile un chemisier de sa mère, puis boutonne un second chemisier au premier et s’en enveloppe, et ainsi de suite une dizaine de fois, alternant chemises blanches et colorées, jusqu’à ne plus pouvoir continuer. C’est une spirale de vêtements ainsi liés les uns aux autres, comme une chaîne, un linceul dix fois enroulé autour de son frêle corps qu’il étouffe : sent-elle alors davantage l’apaisement ou la contrainte ? est-ce son âme qu’elle rapièce ainsi ? D’autres vidéos, plus courtes, la montrent se couvrant d’un manteau vert, nouant sur elle une pelisse de fourrure ou (sur le stand de la galerie Jörg Brockmann à Paris Photo) laçant les bottines de sa mère, puis, en les délaçant, révélant des traces noires laissées sur ses mollets, comme un vestige, une transmission. Connaissant la prédilection de Rebekka Deubner pour les corps, et en particulier pour les fluides corporels, et pour le toucher, on peut imaginer la dimension haptique et odorifère de ces actions, dont le spectateur ne peut voir que ces images muettes. Revêtir ainsi les affaires de sa mère, se glisser dans ce qui fut son enveloppe de tissu, s’approprier cette écorce, cette chrysalide laissées elles aussi orphelines, c’est, pour elle, pour son corps autant que pour son esprit, le travail de deuil le plus intime qu’on puisse imaginer.

Peut-être pour faire pendant à ces vidéos si intimes, le deuxième volet de son travail est plus distant, plus froid, plus « esthétique » aussi : des photogrammes colorés des vêtements de sa mère. Ils composent un tableau multicolore où on reconnait une manche, une bretelle, une dentelle : un portrait en creux de la défunte. Cette appropriation des vêtements (et, un peu, de l’apparence) de sa mère fait écho au travail bien connu de Michel Journiac qui transforme son image pour ressembler à son père ou à sa mère (vivants, eux) dans un Hommage à Freud (en pied de nez) et des Propositions pour un travesti incestueux et masturbatoire. [Tiens, ce serait bien de faire une expo sur « revêtir les habits d’autrui », sur l’identité et l’appropriation vestimentaire, avec ces deux-ci, Hans Eijkelboom, Lygia Clark, Yoshi, qui d’autre ?] Parmi les autres oeuvres de l’exposition, beaucoup de portraits de mères, plus ou moins classiques (Dirck Broekman, Latoya Ruby Frazier, Gao Shan, Paul Graham, Jochen Gerz), des mises en scène drôles (Ragnar Kjartansson, les Blume), voire grotesques (Christian Boltanski), des dialogues tragiques (Mark Raidpere) ou interrogateurs (Anri Sala questionnant le passé communiste de sa mère), des textes d’Hervé Guibert et de Pasolini.

L’autre oeuvre phare de cette exposition, qui, à mes yeux, avec celle de Deubner, éclipse toutes les autres, est la vidéo Measures of Distance de Mona Hatoum, non pas une vidéo, d’ailleurs, mais une série de photographies en gros plan de la mère de l’artiste nue sous la douche, femme forte et sensuelle ; sur ces photographies, comme un rideau, sont inscrites des phrases en arabe, ce sont les lettres de la mère, depuis Beyrouth, à sa fille à Londres, pendant la guerre civile. Les deux se parlent, et, en même temps, Mona Hatoum lit la traduction des lettres en anglais, ce qui est le seul élément compréhensible pour le non-arabophone, mais le fond sonore en arabe est indispensable : entrelacs des conversations entre mère et fille, comme un tissage. Il y est question d’exil, de déracinement, d’épuration ethnique (la Nakba, et c’est une des pièces où Hatoum affiche le plus sa dimension palestinienne), de la séparation entre la mère et ses filles, de la guerre. Il y est aussi question d’intimité, d’identité, de sexualité, et du poids oppressant du père. On (c’est-à-dire l’homme blanc hétéro qui écrit ici) s’y sent un peu voyeur et un peu complice. C’est une magnifique célébration d’amour filial et de complicité. Peut-être est-ce sa dimension méditerranéenne, arabe, avec toutes les complexités et les ambiguïtés que cela implique, qui me la fait aimer.
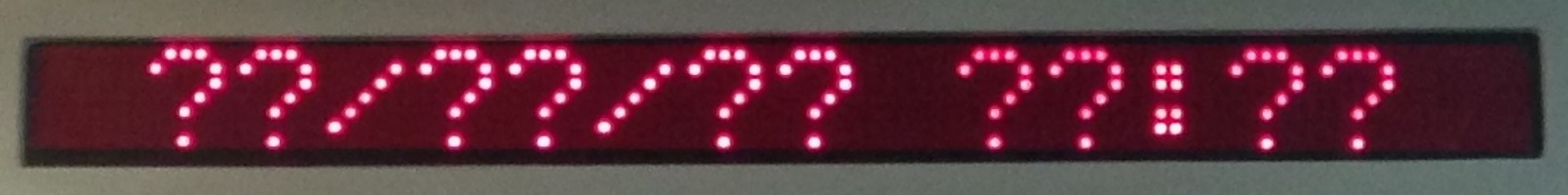

































 L’espace des habitants du
L’espace des habitants du