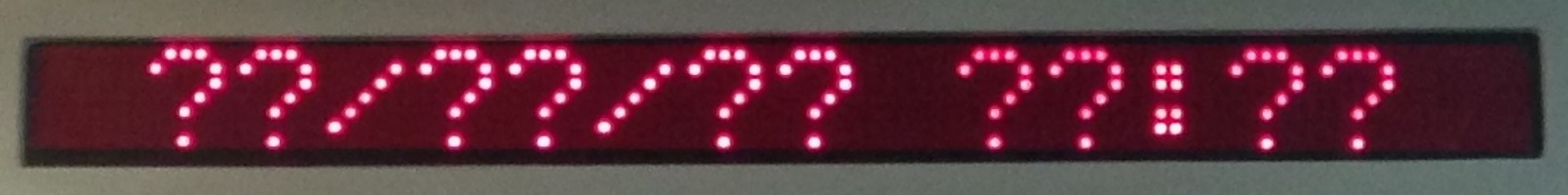Ahlam Shibli, Trauma n.4, Corrèze 2008 2009

Ahlam Shibli, Selfportrait n.16, Palestine 2000
English translation
(Ce billet est mis à jour depuis le 7 juin avec des références nouvelles en fonction du débat)
Peut-être est-ce parce qu’elle n’a pas vraiment de ‘chez soi’, de foyer, de patrie, que l’œuvre d’Ahlam Shibli (au Jeu de Paume jusqu’au 1er septembre) est si forte et si émouvante : c’est un « foyer fantôme », une absence d’état, une histoire niée qui rodent entre ces murs. Il est tout à fait révélateur que la première série (car tout marche ici par séries, une photo seule ne prend son sens qu’intégrée, mise en relation, en cousinage) soit un autoportrait ; non point des photographies du visage de l’artiste, mais une évocation de son parcours, de son histoire, de ses racines, ses ‘territoires existentiels’, ses audaces, sa liberté de penser et d’agir, sa recherche de sens, son rapport au monde, mais le tout est comme rejoué, mis en scène avec deux jeunes enfants. On y voit, entre autres, une petite fille traçant sa route, partant à l’aventure, seule et déterminée. Cette série, un ‘retour sur les lieux qui lui ont montré qui elle est’, est un peu la colonne vertébrale, la clef de l’exposition au sein de laquelle chacune des séries se répond.

Ahlam Shibli, Death n.37, Palestine (Camp de réfugiés de Balata), 12 février 2012
Tout au bout de l’exposition se trouve, comme en écho, la série Death: comment, pour un peuple qui a tout perdu sauf sa dignité, qui a perdu sa terre, son foyer*, dont l’existence est niée par l’occupation, dont l’histoire est réécrite par l’idéologie colonisatrice, dont les fils sont bafoués, emprisonnés, tués, comment donc l’image de la mort est omniprésente, la mort à chaque tournant, la mort sous les bombes aveugles, la mort au combat, dans un ‘attentat-suicide’, en prison, au checkpoint, la mort des résistants, de ceux qui, n’ayant plus rien que leur corps, n’ont d’autre solution que d’investir leur propre vie. Ahlam Shibli fait émerger ici un genre iconographique, le portrait du ‘martyr’, du combattant tué en opérations, un genre iconographiquement très convenu (pose martiale, arme à la main, mise en scène héroïque). Elle n’est pas la première à explorer ce thème, après l’Israélien

Ahlam Shibli, Death n.40, Palestine (Naplouse), 14 février 2012
Miki Kratsman déterminé à redonner un nom, une identité à ces résistants niés par le pouvoir, anonymisés et stéréotypés par l’occupant (et exposant le portrait de Zakaria Zubeidi, chef des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa à Jénine, et alors le combattant de l’ombre le plus recherché par l’armée israélienne, au Musée d’Israël à Jérusalem**), après les Libanais Hadjithomas et Joreige faisant surgir la détérioration des images-fantômes dans l’espace public, après le Palestinien Amer Shomali redonnant sa féminité à une icône de la résistance, après le Libanais Rabih Mroué démontant l’aura médiatique conférée au kamikaze et son incapacité à l’assumer, mais elle le fait de manière plus profonde, plus politique aussi. Elle confronte les portraits dans l’espace public, célébration obligatoire et récupération politique, et ceux dans l’espace intime, familiarité de la mort et ancrage privé dans l’histoire. Le bébé porte le nom de son oncle, mort au combat, et les enfants jouent devant le portrait de leur père, kamikaze disparu, comme devant un autel domestique familier ; chaque photo est accompagnée d’une légende précise, factuelle, nommer est une autre tentative d’empêcher la négation de l’histoire. Le ‘chez soi’ est ici bien précaire, l’armée israélienne détruisant le plus souvent la maison de la famille du ‘terroriste’ : pour construire sa patrie, celui-ci doit voir sa maison détruite, dit Shibli, en jouant sur les mots ‘homeland’ et ‘home’ (à l’inverse des Trackers arabes ci-dessous).

Ahlam Shibli, Death n.33, Palestine (Camp de réfugiés de Balata), 16 février 2012
On peut bien sûr refuser de voir ces photographies, refuser la réalité qu’elles représentent, on peut s’enfermer dans un négationnisme communautaire et pétitionner et manifester pour que l’exposition soit censurée. On peut, en bon propagandiste de l’indignation univoque, vouloir (une fois de plus) empêcher qu’on montre à quel point est mortifère cette idéologie de conquête, de mépris et d’occupation ; on peut, comme toujours faute d’arguments sérieux, invoquer l’islamisme et Merah. L’important n’est pas dans ces soubresauts réactionnaires*** (nous en avons eu bien d’autres ces derniers temps dans les rues de Paris), l’important, c’est de reconnaître ces interrogations, d’accepter qu’une artiste dérange et questionne ces représentations. Ahlam Shibli dit avoir commencé cette série après avoir entendu Julia Kristeva parler du besoin d’avoir des croyances, des prophètes et de les reconnaître comme tels : c’est là l’essence même du judaïsme, mais c’est aussi, pour l’Autre, la nécessité, pour résister et être reconnu, de tenter de générer ses propres icônes. Aux antipodes d’un travail militant ou d’un témoignage documentaire, c’est la réinvention d’une réflexion critique sur le regard subjectif, une distance assumée face à son sujet, aussi poignante que soit la déchirure des sans-foyers.

Ahlam Shibli, Trackers n.1, Israel Palestine 2005
Peut-être la série Trackers devrait-elle être aussi choquante aux yeux de certains pro-palestiniens que la série Death semble l’être aux yeux de certains pro-israéliens, puisqu’elle montre ceux qui sont passés du côté de l’ennemi, ceux qui collaborent, ceux qui, pour avoir droit à une maison (home), détruisent leur patrie (homeland) en se mettant au service de l’armée et en pourchassant leurs propres frères. Mais Ahlam Shibli (dont la série Goter est absente ici) ne porte aucun jugement : fréquentant longtemps les gens qu’elle veut photographier, vivant avec eux, elle établit des rapports de confiance et, photographiant des scènes ordinaires, elle témoigne des ambiguïtés, des douleurs sous-jacentes, des hontes tues et des fiertés inavouées, des compromissions cachées et des avantages acquis, sans dénoncer, sans s’indigner, sans stigmatiser. Dans le cimetière d’un village arabe, les tombeaux de soldats de l’IDF côtoient ceux de feddayin.

Ahlam Shibli, Trackers n.44, Israel Palestine 2005
À cette aune d’étroitesse d’esprit, la série Trauma (en haut) devrait soulever l’ire des anciens combattants français puisque, suite à une résidence en Corrèze, l’artiste joint (ou plutôt montre comment se joignent) la résistance à l’occupation et la colonisation, parfois chez les mêmes personnes, passées du statut d’opprimé à celui d’oppresseur, de victime à bourreau (et c’est là aussi une dialectique israélienne) : dans les listes de nos monuments aux morts, les noms des militaires décédés dans les guerres coloniales en Indochine ou en Algérie suivent les noms de ceux morts en déportation, et nul ne s’en émeut. Là encore, il s’agit de rendre compte d’une réalité indéniable, avec un point de vue critique certes, mais sans mettre personne au pilori. À nous d’y réfléchir.

Ahlam Shibli, Eastern LGBT n.13, International 2004 2006
Révélatrice d’ambiguïtés, Ahlam Shibli nous montre aussi, dans la série Eastern LGBT, des travestis ou transgenres qui ont dû fuir leur pays conservateur et intolérant (Pakistan, Palestine, Somalie,…) pour un Occident (Barcelone, Londres, Zurich, Tel-Aviv) où leur sexualité serait acceptée plus aisément, mais où, une fois établis, ils ne coupent néanmoins pas les ponts avec leur communauté d’origine, menant réellement une double vie : une très belle photo montre l’un d’eux se changeant et se maquillant dans un couloir glauque avant d’aller en boîte de nuit, son seul havre, le seul lieu où il/elle puisse être lui/elle-même. Eux non plus, exclus sociaux, n’ont pas de foyer, eux aussi restent entre deux, eux aussi n’ont plus que leur corps pour s’exprimer, et la photographie leur redonne une dignité et une identité.

Ahlam Shibli, Dom Dzieka n.4, Pologne 2008
Toujours intéressée par les écarts, les marges, les précarités, les déracinements, les transplantations, Ahlam Shibli nous présente, dans la série Dom Dziecka (maison d’enfants) The house starves when you are away, des orphelins ou enfants abandonnés polonais qui recréent là un monde à eux : dépourvus de foyer familial, ils s’en reconstruisent un autre, collectif, à leur initiative, quasiment sans que les adultes interviennent, un monde d’entraide et de convivialité (le contraire de Sa Majesté des Mouches, en somme).

Ahlam Shibli, Dom Dziecka n.27, Pologne 2008
Face aux gesticulations communautaristes (très parisiennes : l’exposition vient de Barcelone où nul n’a tenté de la censurer, et elle va au Portugal, où, très probablement, nul ne le fera), il est important que les spectateurs réalisent que le travail d’Ahlam Shibli est, non pas une apologie du terrorisme comme des propagandistes obtus voudraient le faire croire, mais une réflexion critique sur les ambiguïtés dont nul n’est exempt, sur la manière dont les hommes réagissent face à l’absence ou à la destruction de leur foyer, et s’adaptent aux contraintes qui en résultent. Les visiteurs du Jeu de Paume auront certainement l’intelligence de le comprendre, et de s’élever contre les tentatives de censure de cette exposition.
[Addendum le 11 juin: Des organes de presse ici et là ont repris les éléments de langage de la propagande du CRIF et de ses soutiens selon laquelle cette exposition ne serait consacrée qu’aux auteurs d’attentats-suicide : ‘ »Death » montre des habitants des territoires occupés palestiniens, qui vivent au quotidien avec les photographies des membres de leur famille morts ayant commis un attentat-suicide » (Le Monde, corrigé depuis) et « murs tapis de photos à l’effigie des «martyrs» disparus: terroristes s’étant fait sauter » (Slate); le CRIF, lui, dit que l’exposition montre « comment les familles ou la société palestinienne entretiennent la mémoire des terroristes qui ont été tués lors d’attentats-suicide perpétrés en Israël« .
Il suffit d’analyser même succinctement les données disponibles (sur les cartels ou dans le catalogue) pour voir que le CRIF détourne la vérité (pas la 1ère fois, me direz-vous) : sur les 68 photos de la série Death (rappelons-le, une des six séries de l’exposition), 10 sont des vues d’ensemble sans ‘martyr’ identifié. Parmi les personnes nommées sur les 58 autres photos (certaines à plusieurs reprises), 11 sont des prisonniers, 31 ont été tuées soit au combat, soit par des raids de l’armée israélienne, et 9 sont morts dans des attentats-suicide, d’après les légendes des photographies.
Et on ne parle que de ces neuf là. Mais pour le CRIF et ses amis, c’est tellement plus facile de réduire la résistance palestinienne aux kamikazes …]
- On se souviendra que c’est là le mot employé dans la Déclaration Balfour…
** Une preuve de plus que le public d’Israël, en première ligne, accepte les questionnements que l’art peut générer, souvent bien plus que des lobbyistes français enfermés dans leurs préjugés communautaires.
*** La première réaction est venue, semble-t-il, de cet individu au nom usurpé, bien loin de l’éthique du Silence de la Mer.
Textes accompagnant certaines photographies :
– Trauma #4 : Tulle, 7 juin 2008. Cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière de Puy Saint-Clair en hommage aux combattants des Forces françaises de l’intérieur (FFI), parmi lesquels des Francs tireurs et partisans (FTP) tombés lors de l’offensive de la résistance à Tulle, 7 et 8 juin 1944.
– Death #37 : camp de réfugiés de Balata,12 février 2012. Toile représentant le martyr Kayed Abu Mustafa dans le salon familial. On y lit « La panthère de Kata’ib Chuhada’ al-Aqsa, Mikere » (« Mikere, des Brigades des martyrs d’al-Aqsa »). dans la pièce se trouvent la mère de Mikere, son petit neveu et ses deux enfants.
– Death #40 : Vieille ville, quartier d’al-Qarioun, Naplouse, 14 février 2012. Dans la famille du martyr ‘Ala’ Ghalid. Sa soeur, venue de Tulkarem, a accouché à Naplouse et passe trois jours auprès de sa mère. Elle a donné à l’enfant le prénom de son frère martyr. Ghalid faisait partie des groupes de résistance armée Faris al-Leil (Chevalier de la Nuit). Il fut le premier à poser des bombes contre l’armée israélienne dans son quartier et dans celui d’al-Yasmina. Il a trouvé la mort le 27 mars 2007 lors d’un affrontement avec cette même armée.
– Death #33 : Camp de réfugiés de Balata, 16 février 2012. Photos du martyr Khalil Marshoud, qu’est en train d’épousseter sa soeur dans le séjour de la maison familiale. Sur l’affice, cadeau des Brigades Abu Ali Mustafa, il est présenté comme le secrétaire général des Brigades des martyrs d’al-Aqsa à Balata.
– Dom Dziecka. The house starves when you are away #4 : Dom Dzieka Trzemietowo, 7 octobre 2008, mardi après-midi. Gracjan Schmelter et Tomasz Brzadkowski posent devant l’appareil photo avec une sculpture devant l’entrée de l’orphelinat.
– Dom Dziecka. The house starves when you are away #27 : Dom Dziecka Lubień Kujawski, 17 mai 2008, samedi soir. Pour le dîner, les enfants sont répartis en petits groupes et chaque groupe est responsable de son propre repas. Przemek K. sert Adrian Z., Damian Z., Łukasz Z., Dawid C. et Marcin W.
Quelques critiques de l’exposition :
– Actuphoto
– Paris-Art
– Mouvement (excellent)
– Art in America (sur l’expo à Barcelone)
– Time Out
– Slash
– France TV
– ANSA
Autres lectures pertinentes pour vous enrichir l’esprit, contrairement aux bas-du-front d’en face :
– cette interview
– un beau texte (en Italien) sur un blog de La Repubblica à propos de son exposition à Modène
– ces textes sur Afterall.org : Christian Höller et sur Death (payant)
– cette réflexion sur l’altérité des martyrs
– cette évocation des fantômes qui hantent le Jeu de Paume et que le CRIF fait revivre
– le catalogue de l’exposition, avec toutes les photos de la série Death
– la présentation par Ulrich Loock.
[Addendum le 18 juin (jour prédestiné ?): Lire absolument l’éditorial d’André Rouillé (dont je ne suis pas toujours fan, mais, là oui !) sur les tentatives de censure et les menaces envers le Jeu de Paume à propos de l’exposition d’Ahlam Shibli contre laquelle les propagandistes pro-israéliens ont massivement déployé leur lobby, mais sans grand succès : ils voulaient la censure, ils ont eu un panneau explicatif. Cet article pose remarquablement bien la question de la politique et de l’art en Israël (il mentionne mon amie Sigalit Landau) comme en France, et les dangers pour la culture de laisser faire de telles pratiques fascisantes. Bravo !]
[Addendum le 19 juin : les milieux culturels et artistiques ont été bien lents à se mobiliser sur ce sujet (L’Humanité le rappelle), comme s’ils avaient d’abord eu peur d’affronter le lobby, mais ça y est, ils se mobilisent enfin : tribune de MJ Mondzain, pétitions,.. Il était temps, certains se sentaient un peu seuls dans ce combat contre la censure.]
Photos courtoisie du Jeu de Paume et de l’artiste.
Tout commentaire propagandiste, raciste ou insultant sera supprimé.